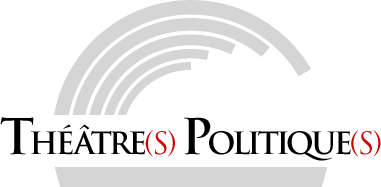La Nouvelle Babylone : un essai d’écriture filmique de l’Histoire
le par Myriam Tsikounas
Un film historique mais aussi une œuvre de propagande
Mais La Nouvelle Babylone est également un film de propagande et ses auteurs mettent tout en œuvre pour imposer leurs convictions au destinataire. Ils n’hésitent pas à forcer le trait pour discréditer les affameurs et magnifier les opprimés.
Les deux groupes ennemis s’opposent d’abord par la mise en scène. Moskvin filme les bourgeois en obliques et en contre-plongées brutales (doc. 12). Les protagonistes qui portent des vêtements aux teintes tranchées, blancs ou noirs, sont généralement placés dans l’ombre — celle d’une casquette allant jusqu’à noircir l’œil du soldat paysan Jean – à proximité d’objets pointus et massifs. Ils dessinent dans le cadre des formes géométriques agressives : triangles, trapèzes, « V » ou « V » inversés.
Au contraire, les communeux, habillés de gris, sont nimbés d’une lumière céleste (doc. 13). Ils sont pris en plongées, réunis en demi-cercles autour d’éléments de décor aux formes molles et douces : sacs empilés, piano à queue…
Pour accentuer l’idée de « vieux monde », presque tous les bourgeois sont des vieillards qui apparaissent exclusivement dans des espaces nocturnes et festifs : bal, café « Empire »… (doc. 14) Ils sont non seulement âgés mais grimés de poudre blanche formant un masque mortuaire. Par ailleurs, l’identité sexuelle des personnages principaux est trouble. Le patron de la Nouvelle Babylone est efféminé et se protège du soleil avec une ombrelle de dentelles. À l’inverse, les femmes, des demi-mondaines sans enfants, sont masculines : elles portent le pantalon et le haut de forme, sont munies de cravaches, et fument le cigare. Les rares couples sont grotesques tel celui que forme une vieille femme obèse assise sur les genoux d’un jeune homme malingre.
Les gens du peuple, en revanche, sont presque tous jeunes, découverts sur leur lieu de travail. Le 18 mars, les femmes arrivent à Montmartre avec leur bébé dans les bras et les figurants ne reviennent pas d’un acte à l’autre mais disparaissent, relayés par d’autres, comme pour souligner le renouveau constant de cette formation sociale.
Les comédiens jouent également de manière très différente selon le camp auquel ils sont censés appartenir. Alors que les acteurs interprétant des communeux sont très sobres, ceux qui prêtent leur corps aux « ventres dorés » se dépensent à outrance, multiplient les gestes inutiles et expriment de façon excentrique leur véritable nature. Au café-concert, une jeune femme s’empiffre, comme pour démontrer qu’elle est « la goulue », au sens propre (doc. 15). Sur la scène, la chanteuse d’opérette (Sophie Magarill), pour signifier qu’elle est une « cocotte », replie les avant-bras sur les coudes, à la manière d’ergots, comme un gallinacé (doc. 16). Elle porte une collerette de plumes et des peignes qui, piqués dans ses cheveux, dessinent des crêtes, ne parle pas mais glousse et se tord la bouche en cul de poule.
Mais pour amener le spectateur à prendre le parti des insurgés, la FEKS va plus loin. Elle retraite, lorsqu’elle évoque les combats dans Paris, non pas les photographies de la Commune prises par Eugène Disdéri ou Hippolyte Blancard, mais l’iconographie de Juillet 1830 et de Février 1848. De la sorte, elle laisse croire, à tort, qu’en mai 1871, comme durant les Trois Glorieuses ou le « printemps des peuples », les ouvriers, la Garde nationale et l’intelligentsia ont combattu côte à côte. Le plan d’un homme qui, au début de l’assaut, tire depuis sa fenêtre est la reprise, animée, du dessin de Bodem Les Assiégés (1830). La femme qui apporte des vivres aux combattants ressemble comme un double à celle du Pont d’Arcole. 28 juillet 1830, d’Amédée Bourgeois (1830). Les autres figurantes, qui soutiennent les blessés ou ravaudent, ont l’air sorties de la lithographie de Victor Adam, Barricade de la place Dauphine, 29 juillet 1830.
Il reste encore aux réalisateurs de La Nouvelle Babylone à faire oublier au public les zones d’ombre de la Commune, ses épisodes les moins connus ou les moins glorieux. À y regarder attentivement, tout au long du film, les plans sublimes et les montages virtuoses ont tous le même objectif : détourner le regard du spectateur et bloquer son questionnement.
Kozintsev et Trauberg mêlent à l’épisode de la défaite quatre plans d’un étendard tricolore qui claque au vent sur une étendue désertique éclairée par un faux soleil. Lors de la première occurrence, le cavalier prussien se trouve loin du drapeau, minuscule au fond du champ. À la quatrième, il est au premier plan, comme pour signifier que l’occupation se renforce, que le péril se rapproche. Ces images sont si belles que le public ne remarque plus les invraisemblances du récit. Il ne trouve plus étrange que la mère de l’héroïne Louise sorte de chez elle à l’annonce de la capitulation de Paris, donc en janvier 1871, et arrive au plan suivant au bas de la butte Montmartre pour empêcher l’armée de prendre les canons de la Garde nationale… le 18 mars 1871 au matin.
Les effets de montage jouent le même rôle. Au bal, un enfant vient remettre une lettre à un journaliste (Sergueï Guerassimov), lequel se lève pour annoncer la défaite des troupes françaises à l’assistance. Immédiatement, des plans de son visage et des plans de jupons de cancan, composés respectivement de six photogrammes et de deux photogrammes alternent. La rapidité est telle qu’elle produit un effet phi. Le destinataire, qui s’interroge sur ce qu’il vient de voir, surimpression ou alternance, oublie de se demander pour quelles raisons cet intellectuel, qui festoie parmi les bourgeois, reparaît juste après au côté des travailleurs, dans le taudis de Louise.
Pour détourner le regard du spectateur, la FEKS instaure aussi, par des montages parallèles, une causalité illusoire entre deux actions autonomes. À plusieurs reprises et toujours pour accentuer la cruauté du vieux monde, les personnages semblent réagir à des épisodes qui se jouent à des kilomètres de là. Sur la butte Montmartre, les militaires se sont emparés des canons. Enfermé dans un théâtre parisien pour assister à une répétition d’opérette, le patron sourit. Un vétéran du 88e régiment de ligne jette son arme. Le patron se lève, furieux. À Versailles, l’armée tire à boulets rouges. Au plan suivant, à Paris, le pianiste juché sur une barricade est mortellement blessé par un obus.