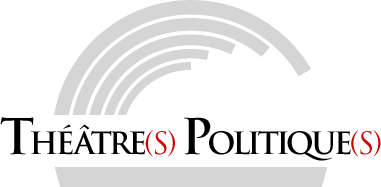Sur Lycée Thiers, maternelle Jules Ferry de Xavier Pommeret (1973)
le par Estelle Doudet
Jouer (à) l’école : critique de l’éducation et pédagogie du message
La pièce de Xavier Pommeret situe la réflexion sur la Commune de Paris au sein d’un, ou plutôt de deux, établissements scolaires qui donnent leurs noms à l’œuvre, « Lycée Thiers », « Maternelle Jules Ferry ». Ce choix suggère d’emblée aux spectateurs la vraisemblance de ce qui va se dérouler – quitte à dénoncer cette vraisemblance au fil de la pièce. Rien de moins inattendu en effet que le nom de ces écoles, qui pourraient se trouver dans n’importe quelle ville du territoire. La célébration des fondateurs est l’un des gestes les plus habituels – et les moins notables – des sociétés républicaines et laïques. Celles-ci étant dépourvues d’origines stables comme peuvent en donner les dynasties dans un système monarchique ou les saints dans une culture religieuse, il est nécessaire, comme le disait Tocqueville, que leur mémoire collective s’inscrive dans l’espace public. Thiers et Ferry servent donc de « saints patrons »Idem, p. 9 aux écoles et plus largement à la société qui se perpétue par elles, c’est-à-dire la Cinquième République.
La généralisation possible du lieu dramatique est cependant nuancée par la structure particulière de l’établissement : l’école des « petites » est une maternelle ; l’école des « grands » est un lycée regroupant des classes préparatoires, particulièrement Polytechnique et Saint-Cyr. Le détail n’est pas anodin : à la différence des préparations « littéraires », ces deux cursus forment non seulement de futurs fonctionnaires, mais des militaires. La juxtaposition des âges, outre la référence ironique qu’elle permet aux représentations traditionnelles des sexes (femmes-enfants ; hommes-soldats), suggère qu’il ne s’agit pas de n’importe quel établissement. Seuls, au centre des grandes villes, les groupes scolaires fondés ou restructurés sous la Troisième République abritent une population aussi hétérogène, à l’instar des grands lycées parisiens Henri IV ou Louis-le-Grand. De nouveau se glisse une allusion à l’époque que les élèves représenteront lors de la cérémonie de fin d’année. L’assimilation possible de cette commémoration et de la distribution des prix, institution caractéristique de l’éducation française jusqu’au milieu du XXe siècle, fait également signe vers la fin du XIXe siècle. La France de 1970 est-elle celle de 1870 ? Peut-elle être gouvernée par les mêmes principes ? La rupture entre républicanisme traditionnel et gaullisme, bien que revendiquée par le personnage principal, est un leurre. La pièce révèle au contraire une continuité entre les idées d’hier et les cerveaux d’aujourd’hui, entre la Troisième et la Cinquième République, faisant de cette dernière la véritable cible de X. Pommeret et l’enjeu de la pièce.
Le choix du lieu scolaire s’impose à plusieurs titres. Il s’agit d’abord de dénoncer le formatage produit par l’éducation, gardienne des valeurs imposées. C’est le principal dessein de la pièce. La première scène présente les enfants de maternelle révisant leurs tables de multiplication. Plus tard, les grands s’exerceront à des démonstrations mathématiques appliquées aux morts de la CommuneIdem, p. 79. « Savoir compter est la base de l’éducation »Idem, p. 9 (première réplique de l’institutrice). La société républicaine, hier et aujourd’hui, est en effet une société d’ordre. Le chiffre y règne, en particulier le chiffre d’affaires. Les préparationnaires, futurs bourgeois, jouent au « monopoly putassier », identifiant les quartiers de Paris par la valeur des corps que l’argent permet d’acheterIdem, p. 76 et suivantes. Les quartiers communards étaient ceux des passes « pas chères » qui séduisent a posteriori les potaches cyniques du XXe siècle. Chiffre, calcul sont plus largement les symboles du bourrage de crâne auquel sont soumis les élèves. Ils s’opposent à la comptine qui permet à la petite Louise Michel de retenir les pluriels des noms en « -al »Idem, p. 19. Car derrière le rythme de cette dernière se cache une « poésie de Théo Ferré » qui dénonce le massacre des communards. L’allusion aux chansons engagées de Léo Ferré permet de confronter la récitation décervelée et tendancieuse valorisée par l’école officielle à la parole libre de l’artiste, chanteur ou dramaturge.
Lieu d’origine des dominations et des clivages sociaux, berceau d’injustices qu’elle amplifie sans les corriger, l’école est dénoncée d’autant plus violemment qu’elle contredit ainsi le rôle égalisateur et libérateur que la République lui donne. Le mensonge de cette école « à l’ancienne », avec ses hiérarchies et ses pesanteurs, a été au centre des critiques estudiantines de mai 1968. « Vous êtes des enfants de Nanterre », dit l’institutrice aux filles dissipées, « vous ne savez revendiquer que la pilule et le désordre »Idem, p. 37. L’attachement du dramaturge à l’université et au théâtre de Nanterre, dont viennent les acteurs, leste ces détails de sens. Lycée Thiers revendique ainsi sans ambiguïtés l’héritage de mai et fait siennes ses réflexions critiques sur l’éducation nationale.
Choisir l’école comme lieu dramatique, c’est aussi poser la question de la puérilité, c’est-à-dire du passage à l’âge de raison. Les petites filles (que Xavier Pommeret souhaitait jouées par de jolies jeunes femmes afin de répondre ironiquement aux attentes libidineuses des spectateurs) savent mieux analyser les discours que les adultes. Louise Michel dénonce la « technique de l’amalgame » qui permet à l’enseignante de justifier la répression versaillaiseIdem, p. 34-35. Au contraire, les hommes politiques joués par les lycéens se disputent leurs mots historiques comme des enfants : « m’sieur m’sieur il copie / ça, c’est moi qui l’avais dit »Idem, p. 40. Édouard de Paladines, le personnage principal, connaît une métamorphose dont la pièce accompagne les étapes, de la croyance aveugle en ce que sa famille et l’école lui ont appris, à la lucidité critique. Dans cette éducation au rebours de l’inculcation scolaire, le désir joue un rôle moteur. Il est d’abord tentation homosexuelle, offerte par le professeur Tolain ; à ce « dévoiement » qui déstabilise le personnage sans le séduire, succède le pur amour pour Clio. Le chant amoureux de Paladines (« Je t’aime, Clio / tu es belle / je veux te voir nue / et que mes yeux ne se lassent pas de te contempler… »Idem, p. 57) est l’acmé de la pièce : le désir sensuel est ici l’image de la libido sciendi, le désir de savoir qui saisit l’homme. Clio, l’Histoire, est alètheia, la vérité qui est révélation, à découvrir dans sa nudité.
La mise en scène scolaire autorise le dramaturge à déployer sa propre pédagogie envers son public. Celle-ci repose entre autres sur les alternances de tons. L’éloge attendu de Thiers se retourne en dénonciation violente ; la ventriloquie par laquelle des lycéens goguenards donnent la parole aux « grands hommes » de jadis fait place à la déclaration lyrique de Paladines à Clio ; la sincérité de cette dernière s’oppose au cynisme désabusé de son oncle, le professeur Tolain ; les récitations enfantines des petites filles dévoilent des renseignements historiques précis sur la répression des communards, crime originel de la République. Ces divers visages donnés de l’école permettent à la fois de dénoncer le faux didactisme et de célébrer l’apprentissage de la vérité.