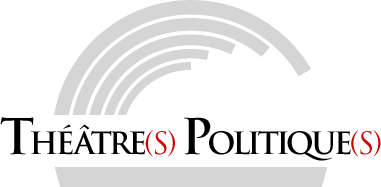La Commune, drame historique (1908)
le par Ary Ludger
ACTE II.
1er tableau
La scène représente un petit café de Paris aux environs des Buttes-Montmartre.
Le rideau se lève.
Le café est plein de sous-officiers de l’armée, de soldats et de gardes nationaux, assis aux tables.
Raoul Mondroit, en lieutenant de la ligne, est assis à une table, sur le devant. Pierre Raison, en sous-officier de la Garde nationale, va et vient, une serviette sur le bras. Julie est pensive, appuyée sur le comptoir.
Scène Ire
Raison – Julie, mais voyons, qu’est-ce que tu fais ?
Sers donc monsieur Raoul !
Autrefois tu n’allais qu’à lui ; à peine était-il là qu’il t’avait à ses côtés.
À présent on dirait que tu ne veux plus le voir.
Julie porte une tasse de café devant Raoul.
Raoul, se levant, lui prend la main – Qu’avez-vous contre moi ? Que vous ai-je fait pour mériter maintenant votre indifférence ?
Julie – Oh ! rien, monsieur Raoul, non, rien. Je n’ai rien à vous reprocher, vous ne m’avez rien fait.
Raoul – Vous n’êtes pourtant plus la même avec moi. Il me semble que vous ne m’aimez plus.
Elle pleure, le mouchoir sur ses yeux.
Julie – Si, Raoul, je suis toujours la même, mon cœur n’a pas changé : je vous aime comme autrefois.
Mais je suis bien malheureuse… Car il faut nous séparer… Je ne peux plus devenir votre femme…
Raoul – Ba ! vous me direz au moins pourquoi ?
Julie – Non, non, je ne vous le dirai jamais.
Sachez seulement que j’ai le cœur brisé… je voudrais mourir…
Elle s’éloigne en pleurant, le mouchoir sur les yeux. Raoul la regarde partir et se rassied d’un geste découragé.
Raoul – Je n’y comprends rien : elle m’aime toujours mais elle ne veut plus de moi…
Oh ! ces femmes, ces femmes ! Est-il possible de connaître le fond de leur cœur ! Est-il possible de dire ce qu’elles aiment ou ce qu’elles n’aiment pas !
Elles ont tout en elles pour faire le bonheur de l’humanité, et pourtant elles ne donnent que des pleurs et des tourments.
Ils semblent qu’elles prennent plaisir à détruire en une heure ce qu’elles ont édifié en des années.
Sont-elles des parjures ? Sont-elles des menteuses ? Ou sont-elles des criminelles ? Je n’en sais rien, non, je n’en sais rien. Mais ce que je sais bien c’est qu’elles sont incompréhensibles.
Scène II
Un Sous-officier de la ligne – Père Raison, il paraît que Paris va se mettre en Commune ?
Raison – Oui, mon ami, oui, ça ne va pas tarder, peut-être bien aujourd’hui. Et pour ma part, je vous déclare que je suis communiste ou socialiste, ce qui est à peu près pareil.
Le Sous-officier – Ah, mais, il faudrait nous expliquer ce qu’est la Commune, à nous qui ne le savons guère.
Tous les sous-officiers et soldats se rapprochent du père Raison.
Raison – Oui, mes enfants, oui, je vous expliquerai la Commune dans son idée comme dans son principe, et vous verrez qu’il n’y a rien de plus beau et de plus juste sur la terre.
La Commune veut le peuple vraiment souverain ; non pas de cette souveraineté factice qu’il possède aujourd’hui et dont on nous parle à chaque instant, sans doute pour nous faire oublier que les milliers et milliers de fonctionnaires qui nous administrent sont tous les maîtres de notre souveraineté.
La Commune reconnaît le Conseil municipal seul maître absolu, sans qu’un préfet, sorti d’on ne sait d’où, nommé par on ne sait qui, puisse casser les votes municipaux.
Chaque village, chaque ville se conduit comme elle l’entend sans qu’un ministre puisse destituer un maire ou dissoudre un conseil. La population seule a ce droit, par de nouvelles élections qui ont lieu chaque fois qu’un tiers des électeurs les demande, mais qui ne peuvent pas se renouveler plus d’une fois par an.
La Commune supprime tous les impôts iniques qui sont établis aujourd’hui sur la terre et sur le travail seulement, et les remplace par un impôt unique sur le capital.
La Commune établit des ateliers nationaux pour tous les travailleurs, comme on en a fait en 48, mais pour bien peu de temps, les exploiteurs capitalistes ayant vite repris les pouvoirs politiques. Avec du travail elle fournit une retraite à cinquante ans à tous les êtres sans ressources. Elle donne l’instruction intégrale à tous les enfants jusqu’à l’âge de vingt ans. Après c’est au concours que se gagnent les professions libérales et le droit de commander aux autres.
La Commune met toutes les fonctions, toutes les charges, tous les emplois à l’élection directe par le peuple.
Nous voyons aujourd’hui de gros bêtas, de stupides ignorants dans de hautes fonctions, bien payées, bien retraitées, uniquement parce que monsieur papa s’est engraissé de la fonction avant eux : ils y sont par héritage.
Eh bien, la Commune finit toutes ces sottises, elle détruit tous ces petits potentats, si superbes et si orgueilleux dans leur belle nullité ; elle coupe radicalement toutes les herbes improductives en mettant les emplois et les charges à l’élection.
Alors plus de faveur, plus de nom, plus de fonctionnaires de père en fils, mais le mérite et l’intelligence à la place du droit héréditaire des familles fortunées.
Le Sous-officier – Ce serait vraiment trouvé tout ça, père Raison. Seulement croyez-vous que le peuple ne commettrait pas de grosses erreurs dans des élections si multipliées ?
Raison – Quand je dis que toutes les charges sont à l’élection, ce n’est pas à croire que la foule irait à décider d’un titre de général, par exemple. Mais s’il faut un officier dans votre régiment, ce sont tous les soldats qui le nommeront. De même que s’il faut un magistrat tous les hommes de loi seront appelés à le nommer.
La Commune abolit les armées permanentes, et tout le monde est soldat jusqu’à cinquante ans, pour marcher à l’ennemi en cas d’invasion seulement.
La Commune supprime les députés, les sénateurs, le président de la République, autant de seigneurs à l’engrais qui ne se doutent même pas de leur inutilité. Elle remplace tout ça par un Conseil national formé d’un délégué par département ; Conseil national qui ne fera point de politique mais seulement de l’économie sociale, accaparant les produits, les vendant au peuple comme à l’étranger.
Et voilà, messieurs, la Commune telle qu’elle doit être ; la voilà dans ses principes de Droit et de Justice.
Le Sous-officier – Mais c’est admirable, père Raison, c’est tout simplement admirable.
Raison – Hé, mon ami, sachez bien que si je suis prêt à combattre pour la Commune, c’est parce que je l’ai reconnue la plus belle expression de la Liberté d’un peuple. Sans doute nos maîtres ne veulent pas de ce mot-là, ils le décrient, ils le dénaturent, parce que de pareils principes leur retirent à jamais la bonne table où chacun s’engraisse si bien et depuis si longtemps avec les sueurs du peuple. Mais la Commune ne veut pas de violences, ne veut pas de sang ; elle n’aspire qu’à la légalité du Droit et de la Propriété du Travail.
Après ça, si un homme du peuple n’est pas communiste-socialiste en connaissant la Commune, il faut que ce soit une véritable tête de chou.
Pour moi c’est du fond du cœur que je crie : « Vive la Commune ! »
Tous les sous-officiers et soldats répètent :
Vive la Commune !…
Scène III
Le rappel bat au dehors… Tout le monde sort du café en disant : « Qu’y a-t-il ? » Le père Raison est sorti un des premiers. Raoul va sortir aussi mais il tombe devant Julie qui s’est rapprochée pour l’arrêter en se plaçant devant lui.
Julie – Raoul, ne me gardez pas rancune. C’est le sort qui nous sépare, et non mon cœur.
Raoul – Mais pourquoi ?
Julie – Je ne puis pas vous le dire.
Raoul – Alors c’est que vous ne m’avez jamais aimé. Sans quoi y aurait-il un sort capable d’obliger à une séparation inexplicable.
Julie – Oh ! ne parlez pas ainsi, vous allez ajouter une dernière douleur à toutes celles qui me torturent déjà.
Raoul – Je ne comprends plus, je ne sais plus ce que j’entends. Vous m’aimez toujours et il ne faut plus nous revoir : n’est-ce pas, voilà ce que vous voulez ?
Julie, presque bas – Oui.
Raoul – Eh bien, je m’en vais pour ne plus jamais revenir. Soyez satisfaite.
Il sort. Julie pleure.
Le rideau se baisse.
2e tableau
La scène représente le siège social de l’Internationale, rue du Temple. Une grande salle, des chaises tout autour ; une grande table longue, recouverte d’un tapis rouge qui tombe jusqu’à terre ; des drapeaux rouges, croisés en faisceaux, autour de la salle ; un bonnet phrygien entre chaque faisceau.
Le rideau se lève.
On bat la générale au dehors.
Delescluze, Flourens, avec deux ou trois civils et quelques officiers de la Garde nationale sont debout au milieu de la salle. Flahutt, à quelques pas, les examine, les bras croisés.
Rochefort et Ferré arrivent par le fond.
Scène 1re
Ferré – Qu’y a-t-il, Delescluze ? Pourquoi bat-on la générale ?
Il entre des officiers, une quinzaine.
Delescluze – Il y a que nos hésitations vont nous perdre, et que j’y coupe court en précipitant les événements. Car sachez bien que nous sommes prêts d’être débordés.
Ferré – Comment ça ?
Delescluze – Je tiens de source sûre, que l’armée va s’emparer de nos canons des Buttes-Montmartre aujourd’hui même, si nous n’allons vite au secours de ceux qui les gardent.
Voilà la décision secrète du gouvernement de Paris et de son conseil.
Aussi ne vous ai-je pas toujours dit que nous perdions notre temps dans de vaines attentes, et que l’on aurait déjà dû agir ? Ne vous ai-je pas toujours dit que c’est surtout par les coups imprévus et précipités que nous arriverions à tomber nos adversaires ?
Mais Rochefort, lui, recule toujours le moment de l’action ; il est toujours là pour faire croire que les évènements vont s’accomplir tout seuls.
Rochefort – Si j’ai reculé le moment d’agir, c’est que je ne nous voyais pas suffisamment prêts.
Delescluze – Pas prêts ! avec deux cent mille gardes nationaux armés, et presque toute l’armée de ligne de Paris pour chasser les débris de cet Empire écroulé qui tiennent encore toutes les charges du Gouvernement. Et tu pousses à l’inaction, tu recommandes la patience ! Dans quel but ? Est-ce pour donner aux autres le temps de reconstituer une bonne armée avec les troupes qui reviennent déjà d’Allemagne, alors que celles de Paris sont à peu près dévouées au peuple ?
Rochefort – Citoyen Delescluze, vas-tu m’accuser de favoriser les gens de l’Empire ?
Delescluze – Non, mais je t’accuse de ne pas savoir ce que tu veux. Et je suis bien certain que personne ne contredira mes paroles.
Tu es très fort pour chercher mais très faible pour marcher.
Rochefort – Après tout, quelle authenticité ont tes renseignements ?
Delescluze – L’authenticité d’un homme qui a tout entendu.
Il montre Flahutt.
Flahutt – Moi-même, messieurs, moi-même, qui ai tout vu de mes yeux et tout entendu de mes oreilles dans le cabinet du gouverneur de Paris, où je pénètre quelquefois… pour vous servir.
Je vous dirai même que si le Gouvernement ne parvient pas à s’emparer de vos canons, il va s’enfuir à Versailles pour reconstituer là de plus sûrs moyens d’attaque contre vous.
Tout le monde – Ha ! ha !
Delescluze – Qu’en pense le citoyen Rochefort ?
Rochefort – Je pense qu’il faut faire des barricades dans tout Paris.
Delescluze – Eh bien, nous différons encore sur ce point, en ce que je pense que c’est le moment de faire le coup de feu et non des barricades.
Nous sommes assez nombreux et assez armés pour nous mettre face à face avec nos adversaires.
Je propose, en outre, de fermer les portes de Paris afin que personne n’en puisse sortir.
Rochefort – Ah ! par exemple, ce serait une grosse sottise. S’ils veulent nous laisser la place, ne les obligeons pas à lutter, puisque la fuite nous débarrasse d’eux.
Tout le monde – Oui, ça vaut mieux.
Delescluze – Vous le voulez, je le veux bien aussi. Mais rappelez-vous qu’un Gouvernement échappé est presque toujours un Gouvernement vainqueur quand il possède des troupes comme celles qui arrivent actuellement d’Allemagne.
Rochefort – Non, non, il est préférable de les laisser partir. Nous deviendrons les maîtres sans répandre de sang.
Delescluze – Les maîtres d’un moment pour être plus sûrement vaincus, quand les prisonniers d’Allemagne seront arrivés, eux qui n’ont point pris l’esprit du peuple comme les troupes actuelles.
En somme, faut-il les laisser partir de Paris s’ils le veulent ?
Tous – Oui.
Delescluze – Et nous allons défendre les canons des Buttes-Montmartre ?
Tous – Oui, aux canons, aux canons…
Tous sortent pendant que la générale reprend au dehors.
Le rideau se baisse.