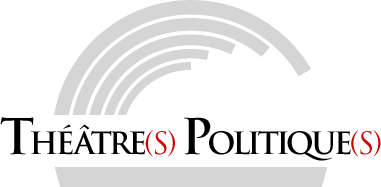La Commune, drame historique (1908)
le par Ary Ludger
ACTE V
1er tableau
La scène représente une longue barricade partant obliquement du devant de la gauche au fond de la droite. À gauche, dans le fond, des maisons et une rue. À gauche on peut pénétrer dans la barricade par une petite rue libre, tout à fait sur le devant. Un large drapeau rouge est planté sur la barricade.
Le rideau se lève.
Delescluze et une trentaine de gardes nationaux sont dans la barricade. Ils tirent, Delescluze comme eux. Raoul, en simple garde national, est un peu sur le devant de la gauche. Il tire aussi. Flahutt est sur le devant de la droite, mais sans arme.
Au loin, Paris brûle.
Scène Ire
Delescluze – Cessez le feu. Ils se sont tous retirés, je crois.
Flahutt – Citoyen Delescluze, ne pensez-vous pas qu’il serait temps de se retirer aussi sur le Père-Lachaise pour échapper au danger de l’explosion ?
Delescluze – Quelle explosion ?
Flahutt – Mais l’explosion de Paris qui doit sauter au dernier moment. Vous le savez bien pourtant ?
Delescluze – Je sais que l’explosion de Paris est un conte de vieilles femmes. Voilà ce que je sais.
Flahutt – Comment, le dessous de la ville n’est pas bourré de dynamite ?
Delescluze – Il n’y a pas plus de dynamite en-dessous que je n’en ai sur la main. Nous avons fait courir ce bruit pour intimider les Versaillais, tout simplement.
Par exemple, quel est donc l’être qui oserait pareille abomination.
Delescluze s’avance pour regarder par-dessus la barricade, Flahutt reste seul un peu à l’écart.
Flahutt – Malédiction ! Mon œuvre ne sera pas complète.
Il sort par la droite.
Scène II
Le père Raison arrive par le devant de la gauche, un fusil à la main.
Raison – J’arrive, mes amis, j’arrive.
J’avais cédé aux pleurs de ma fille et j’étais rentré chez moi, mais ce qui s’accomplit en ce moment dans tout Paris est si épouvantable, que je veux maintenant mourir les armes à la main.
Une malheureuse jeune fille de dix-huit ans à peine, vient d’être éventrée sous mes yeux pour avoir dit à un soldat dont la baïonnette était rouge de sang :
« Vous avez du sang de vos frères à votre baïonnette… »
L’autre lui traversa le ventre d’un coup de baïonnette en répondant :
« Tiens, j’aurai aussi du sang de mes sœurs… »
Louise Michel est entrée aussi par la gauche. Elle écoute les dernières paroles de Raison.
Louise Michel – J’ai vu fusiller une pauvre mère avec son petit enfant dans les bras… Qu’avait-elle fait ? Une misérable prostituée l’accusait d’avoir travaillé aux barricades.
Le dernier des misérables, qui accuse quelqu’un, fait donner la mort immédiatement. Les prisonniers, gardes nationaux, je ne vous en parlerai pas, on les coupe en morceaux, on les déchire à coups de sabre.
Et c’est ainsi dans chaque rue, dans chaque quartier ; c’est ainsi dans toute la ville. Ils brûlent Paris avec leurs bombes et leurs obus en nous accusant de mettre le feu avec du pétrole.
À Raison.
Sergent, allez donc au numéro douze de cette rue, ils percent un mur pour tourner la barricade. Vous les prendrez peut-être au passage.
Raison sort par la gauche avec une dizaine de gardes nationaux.
Louise Michel, à Delescluze – C’est triste à dire, mais l’homme est un monstre pour son frère. Aucun animal ne hait plus son espèce que l’homme hait la sienne. Quand un soldat étranger tombe prisonnier de guerre, on le soigne, il est un vieil ami ; et quand un Français se rend à des Français, on l’égorge tout de suite.
C’est encore trop peu, il faut éventrer des femmes et des enfants sur le seuil de leur porte, ou brûler des familles entières dans l’intérieur de leur maison.
Pauvre progrès, pauvre lumière…
Delescluze – La réaction a toujours été impitoyable dans ses vengeances : c’est la fusillade en tas, c’est le massacre en bloc…
Les républicains eux-mêmes, lorsqu’ils sont au pouvoir, deviennent de véritables bourreaux pour le peuple, s’il ose les combattre : vois Cavaignac en 48, inondant Paris de sang pour étouffer la Commune naissante… Vois le Directoire en 96, faisant mitrailler le peuple à Saint-Roch… Vois la Convention en 94, guillotinant les Montagnards et tous les derniers défenseurs du peuple avec eux, sans procédure et sans jugement…
Tout ce qui aspire à la domination doit être implacable dans ses moyens. Réactionnaires et républicains l’ont été jusqu’à l’excès jusqu’à la plus noire barbarie.
Tels ils ont été, tels ils resteront, jusqu’au jour où le peuple comprendra que lui seul est coupable de ses misères, puisqu’il donne la puissance politique à ses propres ennemis, les exploiteurs de la masse, ambitieux sans cœur et sans scrupule, tous ligués pour maintenir les travailleurs dans la chaîne des maîtres.
Le père Raison revient avec ses hommes, conduisant quatre soldats prisonniers.
Scène III
Raison – Citoyen général, en voilà quatre que nous avons pris dans leur souricière.
Delescluze – Eh bien, soldats de Versailles, qu’attendez-vous de nous ? Qu’attendez-vous des brigands qui ont fusillé vos chefs Lecomte et Clément-Thomas, comme vous le dites si bien ?
Les otages aussi viennent d’être fusillés, mais c’est par une machination incompréhensible, car la Commune n’en a pas donné l’ordre. Il y a un mystère là-dedans que nous ne comprenons pas.
La Commune n’a jamais fusillé un prisonnier, alors même qu’on massacrerait les siens, parce qu’elle ne frappe pas sur le peuple, mais sur les oppresseurs du peuple. Tel est son principe.
Tant pis si nous sommes aujourd’hui ce que nous étions hier : Versailles qui assassine et la Commune qui pardonne…
Retournez parmi les vôtres, allez dire à ceux qui égorgent nos frères, que la Commune vous a donné la vie et la liberté…
Allez… vous êtes libres…
Les soldats s’en vont par le même chemin.
Scène IV
Le père Raison regarde par-dessus la barricade.
Raison – Attention, ils sont revenus.
Tous les gardes nationaux se placent à leur poste de combat.
Delescluze – Ne tirez pas avant que ces quatre soldats aient disparu.
Raison – On ne les voit plus.
Delescluze – Alors montrons maintenant aux Versaillais que la Commune ne pardonne pas pour acheter son propre pardon.
Il prend le drapeau et monte debout sur la barricade, le sabre à la main droite, le drapeau à la main gauche. Il commande d’une voix retentissante :
Feu !…
Raoul jette son fusil en disant :
Raoul – Je n’ai plus de cartouches…
Une effroyable décharge répond au tir des gardes nationaux. Des coups de canons retentissent, Delescluze s’affaisse sur la barricade, mais il se relève aussitôt en criant :
Delescluze – Vive la Commune !… À bas Thiers ! À bas Mac-Mahon, les égorgeurs du peuple ! Vive la Commune !…
Il s’affaisse de nouveau et tombe dans les bras des gardes nationaux qui le déposent à terre, sur le drapeau.
Raoul – Il est mort…
Louise Michel – Noble cœur, puissent les générations futures prendre en exemple un jour, et ta vie et ta mort…
Louise Michel se retire par la droite en tenant son mouchoir sur les yeux.
Scène V
Julie arrive par la gauche en courant.
Julie – Partez mon père, partez tous. Ils percent les maisons : la barricade va être tournée dans un moment. Partez, partez vite.
Raison – Mais toi, malheureuse enfant, retourne à la maison.
Julie – Non, non, je ne veux plus vous quitter.
Raison – En retraite, camarades, et bien vite.
Tous les gardes nationaux s’en vont par la droite. Raoul ne bouge pas.
Julie – Venez, Raoul…
Raoul ne bouge pas.
Raoul – À quoi bon… je veux mourir ici…
Julie – Non, venez, nous pouvons peut-être échapper encore.
Je ne veux pas que vous mouriez ou je mourrai avec vous…
Venez, venez…
Elle l’entraîne par la droite. Les soldats apparaissent de l’autre côté de la barricade. Ils tirent, le canon gronde. Les soldats escaladent la barricade.
Le rideau se baisse.
2e tableau
La scène représente la place devant le cimetière du Père-Lachaise. À droite, le cimetière ; à gauche, une grande rue. Au loin, Paris brûle toujours.
Le rideau se lève.
Des gardes nationaux, commandés par Raison, emplissent la scène. Ils tirent vers la grande rue. Une vive fusillade leur répond. Le canon tonne. Julie est sur le devant, à côté de Raoul auquel elle a passé ses deux bras autour du cou.
Scène Ire
Raison – Attendez, ne tirez qu’à coup sûr, car les cartouches vont manquer.
Nous ne pouvons plus échapper mais au moins faisons-leur payer notre mort.
Tous s’arrêtent de tirer, ayant le fusil prêt. Une accalmie dans la fusillade réciproque.
Raoul – Quand la vie m’enivrait de ses espérances, vous m’avez repoussé ; pourquoi revenir maintenant que je vais mourir ?
Julie – Raoul, laissons les souvenirs douloureux. La vie ne pouvait plus nous unir, mais je viens mourir avec vous… N’êtes-vous pas satisfait ?
Raoul – Mourir… vous si jeune et si belle…
Julie – Oh ! je n’aime plus ni la jeunesse, ni la beauté depuis que je vous ai perdu.
Raoul – Quel est donc cet étrange mystère ?
Julie – Raoul, je ne veux plus que le bonheur de mourir avec vous ; je ne pense plus qu’à celui-là. Ne me parlez pas d’autre chose.
Les gardes nationaux tirent encore, mais seulement quelques coups, l’un après l’autre.
Raison – Cessez le feu, allez. Toute résistance devient inutile : nous n’avons plus de cartouches et nous sommes cernés…
C’est maintenant le moment de mourir…
Tous les gardes nationaux jettent leurs fusils en se formant d’un groupe compact vers la droite. Ils entonnent le refrain de « l’Internationale » mais en transposant le deuxième vers.
Tous – « C’est la lutte finale,
Nous mourrons, mais demain,
l’Internationale
sera le genre humain. »
Scène II
Les soldats arrivent par la gauche, alignés et le fusil en joue sur les gardes nationaux qui chantent.
Un Officier – Rendez-vous…
Raison – Nous sommes rendus, je pense, puisque nous avons jeté nos fusils.
En ce moment Flahutt perce les gardes nationaux par la droite et se présente à l’officier en lui montrant un grand papier. L’officier le prend et lit.
Scène III
Julie – Mon père, voilà l’homme de Ferrières…
Raison – Celui-là ?
Julie – Oui.
Raison – Il me semblait bien aussi l’avoir vu quelque part.
Heureusement, il y a encore une cartouche dans mon fusil.
L’officier remet le papier à Flahutt pendant que Raison ramasse son fusil, un peu caché par Raoul et Julie.
L’Officier – Monsieur, vous êtes libre, vous pouvez passer.
Aux soldats.
Laissez passer monsieur.
En ce moment Raison ajuste subitement Flahutt et lui tire dans le dos. Celui-ci tombe en poussant un cri.
Flahutt – Ah !…
L’Officier – Feu…
Le premier rang des soldats tire sur les gardes nationaux, en tuant une partie. Le deuxième rang tire à son tour et tue le restant.
Tous les gardes nationaux tombent en criant : « Vive la Commune ! Vive la Commune ! »
Raoul et Julie tombent enlacés et s’embrassant.
Le père Raison tombe le dernier, jetant son fusil devant les soldats et répétant :
Raison – À bas Thiers ! à bas Mac-Mahon ! les deux bourreaux du peuple ! Vive la Commune !
Une dernière décharge l’abat près de Julie et de Raoul.
Le rideau se baisse.
Fin