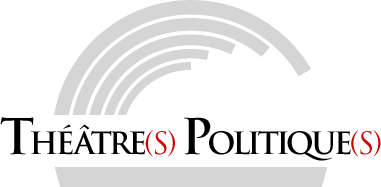La Commune, drame historique (1908)
le par Ary Ludger
ACTE I.
La scène représente un salon du palais Rothschild, à Ferrières.
Le rideau se lève.
Guillaume 1er, en costume militaire prussien, est assis autour d’un guéridon chargé de papiers, Bismarck, également en costume militaire, se promène dans le salon, les mains derrière le dos.
Scène Ire
Bismarck s’arrête devant Guillaume.
Bismarck – Ce n’est pas assez pour moi d’avoir abattu la France par les armes, non, ce n’est pas assez. Car tant qu’il restera un peuple français la Prusse sera en danger et l’Allemagne ne parviendra jamais au rôle prédominant que le succès de ses armes lui a tracé.
Guillaume – Mais alors que voulez-vous pour la France ?
Bismarck – Je veux, je veux… quelque chose de mieux.
Guillaume – Il me semble pourtant que le but est largement atteint : cinq milliards à payer, un milliard de contributions de guerre imposées sur notre passage, ça fait six ; deux provinces enlevées ; les deux tiers du territoire ruinés à fond ; plus d’armée, plus d’armement ; une dette écrasante, et qui va maintenant toujours augmenter avec rapidité, cela me semble bien suffisant pour finir la France et les Français.
Une nation qui reçoit de pareils coups n’est plus à craindre. Elle aura peut-être encore un effort, mais cela ne sera qu’une convulsion de l’agonie pour s’éteindre de soi-même petit à petit.
Bismarck – C’est justement cette convulsion que je voudrais épuiser jusque dans son épuisement afin que le corps tout entier devînt matériellement incapable de reprendre aucune énergie. Non pas que la France me paraisse susceptible de redevenir dangereuse, mais seulement nuisible pendant un temps que nous pouvons abréger si nous savons bien nous y prendre.
Tant qu’à un relèvement quelconque il est bien impossible désormais. Puisque l’on comptait six milliards à six milliards et demi de numéraire en France, et que nous en prenons six, avec quoi s’armerait-elle ? Les autres puissances ne lui prêteront pas d’argent dans pareille condition.
Mais il faut pourtant bien comprendre que le peuple français se compte encore par trente-six millions d’âmes, et que pareille nation, quoique ruinée à fond, ne s’éteint pas sans nuire singulièrement à ses ennemis.
Voilà pourquoi je dis, que la France, si abaissée soit-elle, restera toujours un obstacle à l’avenir de l’Allemagne.
Guillaume – Que voudriez-vous faire ?
Bismarck – Lui susciter une grande guerre civile… une de ces guerres d’intérieur qui détruisent plus sûrement que toutes les armées étrangères parce qu’elles rendent un peuple ennemi de soi-même.
Après l’invasion, la guerre civile… Ce serait l’apothéose du triomphe allemand.
Guillaume – Mais est-elle possible, cette guerre civile ?
Bismarck – Ah ! il ne tient qu’à nous de la faire éclater, peut-être pour demain. Les insurgés sont prêts ; s’ils hésitent encore c’est qu’ils craignent que nous ne voulions reconnaître que le seul gouvernement ayant conclu la paix.
Guillaume – En somme, si l’insurrection triomphait, qui paierait l’indemnité ?
Bismarck – Il vaudrait peut-être bien mieux qu’elle ne fût jamais payée. Nous pourrions ainsi conserver une des plus riches régions de la France et qui rapporterait certainement les cinq milliards en quelques années alors que le pays serait quand même à nous.
Et puis cette dette serait une raison vivante d’attaquer toujours et de prendre jusqu’au cœur de la France : ce auquel les puissances n’auraient rien à dire.
Guillaume – Alors vous croyez ?
Bismarck – Je crois qu’il faut une bonne guerre civile à la France. Je crois qu’il faut, non seulement pousser les insurgés, mais leur promettre notre appui moral, tout comme le promettre au gouvernement établi afin de ne pas le laisser hésiter à la lutte.
Voilà ce que je crois, et voilà ce qu’il faut pour le dernier triomphe des armes prussiennes.
Guillaume, en se levant pour sortir – Agissez, en ce cas, agissez au plus tôt. Mais surtout rien d’officiel.
Bismarck – Oh ! certainement non, rien d’officiel, pas un mot, pas même une virgule. Il faut que la Prusse fasse tout et qu’elle n’y soit pour rien. Voilà le rôle.
Guillaume s’en va par la droite. Bismarck le reconduit jusqu’à la porte, tout en prononçant ses dernières paroles, puis il revient s’asseoir au guéridon et prend des papiers en mains.
Scène II
Flahutt, homme de confiance de Bismarck, entre doucement par la gauche.
Bismarck – Ah ! monsieur Flahutt, j’allais justement vous appeler.
Flahutt – Je suis heureux d’éviter cette peine à votre Excellence.
Bismarck – Dites-moi, voulez-vous aller à Paris ?
Flahutt – Je suis aux ordres de votre Excellence.
Bismarck – Vous irez donc à Paris. Vous vous mettrez en relation avec tous les noms qui sont notés là-dessus.
Il lui remet une feuille.
Et vous les assurerez de mon appui moral, mais en votre nom seulement.
Comprenez-vous ?
Flahutt – Excellence, je comprends.
Bismarck – Vous pourrez même leur promettre tout ce que vous voudrez, pourvu que ce soit toujours en votre nom.
Comprenez-vous bien ?
Flahutt – Excellence, je comprends bien.
Bismarck – Votre présence va probablement faire éclater la guerre civile. C’est ce que j’attends.
Avec les insurgés vous tiendrez contre le gouvernement établi ; avec le gouvernement établi vous tiendrez contre les insurgés. Mais en poussant les deux partis aux dernières extrémités, leur fournissant même les moyens de s’entre-détruire. Enfin vous vous servirez de l’un en trahissant l’autre, et vous ferez de même pour les deux.
Comprenez-vous bien encore ?
Flahutt – Excellence, je comprends bien encore.
Bismarck – Alors préparez-vous à partir le plus tôt possible.
Flahutt – Excellence, c’est que…
Bismarck, en riant – Ah ! il y a un – c’est que !
Flahutt – Oui, Excellence, et ce n’est pas là le moins intéressant : une adorable jeune fille que je venais mettre dans les bras de votre Excellence…
Bismarck, riant plus fort – Oh, oh ! monsieur Flahutt, c’est encore une de vos surprises !…
Flahutt – Il faut bien que votre Excellence se repose quelquefois des fatigues du pouvoir si nous ne voulons pas que le poids du travail l’accable trop jeune et trop tôt pour la Patrie.
Bismarck, tout en examinant ses papiers – Et comment avez-vous pris cette jeune colombe, adorable, comme vous le dites ?
Flahutt – C’est presque une histoire, Excellence.
La jeune fille est de Paris…
Bismarck – Une Parisienne.
Flahutt – Une Parisienne tout ce qui a de plus piquant, gracieuse comme un oiseau.
Bismarck – Diable !
Continuez.
Flahutt – La jeune fille est donc de Paris. Mais elle est venue pour passer le siège à Ferrières, chez une tante.
Maintenant que la paix est signée, le papa vint hier chercher sa fille. Ils allaient s’embarquer tous les deux quand, je ne sais par quelle heureuse fatalité, la jeune fille resta seule un moment dans la rue, son père étant entré au bureau de tabac. En cet instant un soldat de la Garde s’est permis de chiffonner la taille de la petite, et le père, qui sortait alors, tenant à la main un espèce de bâton de voyage, en a presque cassé la tête du soldat.
Le coupable, arrêté immédiatement, est aussitôt jugé par la cour martiale qui le condamne à mort.
Mais comme l’acte s’est accompli dans la zone militaire de la résidence impériale, l’exécution du condamné ne peut avoir lieu sans qu’elle soit signée de votre excellence, qui a dû en recevoir la feuille.
Bismarck – Oui, c’est vrai, j’ai reçu un arrêt d’exécution à signer.
Il est par-là, quelque part dans ces papiers.
Flahutt – Votre excellence ne le signera pas. Car la petite vient demander la grâce de son père. Et je ne crois pas qu’il soit possible de la lui refuser, surtout en la voyant pleurer, quand les larmes la rendent encore cent fois plus belle.
Bismarck – Vraiment ?
Flahutt – C’est comme je le dis à votre Excellence.
Bismarck – Où est-elle ?
Flahutt – Dans le salon sombre…
Bismarck – Pensez-vous qu’elle me recevra bien, si je me présente ?
Flahutt – Oh ! pour la grâce de son père, elle recevra bien tout ce que lui présentera votre Excellence.
Bismarck – Allons la voir alors.
Il va pour sortir par la gauche.
Préparez-moi toujours une lettre de grâce ; nous verrons si je dois la signer ou signer l’exécution.
Flahutt – Votre Excellence signera la grâce, j’en suis bien certain.
Bismarck sort et Flahutt cherche dans les papiers.
Scène III
Flahutt, tout en remuant les papiers – Ce brave Bismarck, il a un caprice pour les Parisiennes, un fort caprice. Chaque fois que je lui dis : c’est une Parisienne… son œil s’enflamme d’un feu plus brûlant.
Caprice de grand homme, probablement. Car il me semble que la jeunesse est bien belle partout, surtout la jeunesse sage.
Mais il faut pourtant reconnaître que les petites Parisiennes tiennent un charme autrement agréable que celui des petites Prussiennes. Ici c’est léger, gracieux, pimpant et coquet, pendant que là-bas, c’est lourd et mal tourné.
Scène IV
Bismarck entre avec Julie qui s’essuie les yeux.
Bismarck – Oui, nous allons arranger cette affaire.
Il va s’asseoir.
Flahutt – Excellence, voici l’ordre d’exécution et voici la lettre de grâce.
Il montre deux feuilles qu’il a mises à côté l’une de l’autre. Bismarck prend la plume que présente Flahutt, et signe une des deux feuilles qu’il remet à Julie.
Bismarck – Tenez, voilà pour votre père.
Du moins, non, procédons autrement.
Il reprend la feuille et la donne à Flahutt.
Monsieur Flahutt, allez porter cette grâce et faites amener l’homme ici.
Flahutt s’incline profondément.
Flahutt – Excellence, dans une minute.
Il sort par la gauche.
Bismarck s’approche de Julie qui a remis son mouchoir sur les yeux.
Bismarck – Allons, séchons ces pleurs, votre père vous sera rendu.
Julie – Mais moi, monsieur, comment lui serai-je rendue ?
Bismarck – Ah ! ma foi, que voulez-vous ! Il faut savoir prendre la vie comme elle se présente.
Scène V
Quatre soldats prussiens, arme en bras, commandés par un sous-officier, entrent avec Raison, père de Julie. Flahutt les conduit.
Julie court se jeter dans les bras de son père.
Julie – Ah ! mon pauvre père vous voilà enfin !
Raison – Comment, toi ici ?
Julie – Oui, mon père, j’y suis venue chercher votre grâce.
Raison – Et tu l’as obtenue ?
Julie, baissant la tête – Monsieur de Bismarck vient de la signer.
Mais si vous saviez ce qu’elle me coûte…
Elle se cache le visage sur l’épaule de son père.
Raison – Ah ! je ne le devine que trop. Mais pourquoi es-tu entrée dans ce repaire de brigands ?
Bismarck se redresse.
Bismarck – Monsieur, vous oubliez déjà que vous devez la vie à ma clémence ?
Raison – Et ma fille, que doit-elle à votre clémence ?
Julie – Mon père, c’était pour vous sauver.
Raison – Il fallait me laisser mourir…
À Bismarck.
C’est un crime de plus à mettre sur la liste des lauriers prussiens.
Voilà votre clémence, Monsieur de Bismarck.
Bismarck s’est levé, le regard furieux.
Bismarck – Si vous croyez que le pardon vous permet de nouvelles fautes, eh bien, vous vous trompez.
Raison – Votre pardon n’est qu’un infâme outrage à l’amour que me portait cette enfant. C’est le pardon d’un misérable.
Bismarck – Assez, monsieur, assez ! Vous serez récompensé de vos insultes, et cette fois, sans pitié.
Soldats…
Julie se met devant Bismarck.
Julie – Je vous en prie, monsieur, n’oubliez pas que sa vie ne vous appartient plus, puisque vous me l’avez donnée.
Bismarck – Emmenez-le donc, alors, emmenez-le ! ou sur ma vie, je le fais fusiller, même après sa grâce…
Julie entraîne son père par la gauche.
Bismarck – Aucun homme sur la terre ne tiendrait impunément pareil langage devant moi. Et je le laisse partir.
Le rideau se baisse.