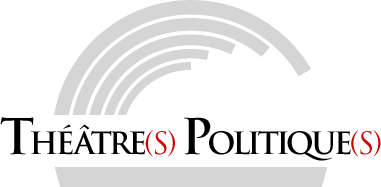Un Théâtre de façade subversif et engagé : désordre de l’Histoire et faux retour à l’ordre chez Georges Darien
le par Thanh-Vân Ton-That
Communards et anticommunards
À l’époque où la France commence à se diviser entre dreyfusards et « anti », le spectre de la guerre civile ne s’est pas complètement évanoui. Si le théâtre est un « miroir de concentration » pour reprendre la définition de Hugo dans la Préface de Cromwell, Georges Darien préfère aux scènes de foule des drames romantiquesChez Musset (Lorenzaccio) ou Hugo (Le roi s’amuse). un huis-clos limité à quatre personnages (six en incluant la bonne et l’officier), « ces quatre individualités qu’on pourrait prendre pour des symboles »L’Ami de l’ordre, p. 31 dont les arrivées successives annoncées par les didascalies sonores (« On sonne »Idem, p. 8, 13) structurent la pièce, conformément à la tradition théâtrale : La Pétroleuse et L’Abbé, anonymes, sa servante Marie appelée par son prénom conformément aux usages, M. de Ronceville au nom paradoxal, aristocrate de la campagne transplanté en milieu urbain, M. Bonhomme au nom trompeur. On est loin des trois actes, des vingt-six tableaux et des nombreux personnages et des décors urbains d’Adamov dans Printemps 71 (créé en 1963) ou du panorama de Brecht dans Die Tage der Commune (1949) rassemblant plus d’une soixantaine de personnages anonymes ou célèbres. Puisque la réalité foisonnante de l’Histoire doit se retrouver sur scène avec des contraintes spatiales et temporelles, alors qu’on associe à la Commune des scènes de foule et d’extérieur qui sont autant de topoï historiques (Montmartre, Hôtel de ville, barricades, Père-Lachaise ou la rue Pigalle chez Brecht), le microcosme présente une galerie restreinte de personnages qui sont des types tout à fait représentatifs de la société divisée, chacun illustrant des points de vue divergents. Les faits rapportés par L’Abbé et M. Bonhomme permettent d’évoquer indirectement les mouvements de la foule haineuse et vindicative pourtant absente de la scène. Georges Darien associe métonymiquement un personnage à une classe sociale et politique qu’il représente avec ses valeurs et sa vision du monde. Dans un genre et un registre différents on se souvient des compagnons de voyage de Boule de suif, ces échantillons de la société et de l’espèce humaine épinglés par Maupassant ou bien des saynètes des chapitres de Bouvard et Pécuchet qui révèlent les tentations théâtrales de Flaubert.
L’expérience consiste à mettre à l’épreuve les personnages et à observer leur réaction (presque au sens chimique du terme) face aux événements, la mimesis permettant à l’auteur de s’effacer en laissant au spectateur le soin de juger par lui-même derrière une fausse neutralité. En effet la vision est orientée, visant à corriger le discours officiel de l’Histoire pour atténuer le climat de réprobation politique et morale presque unanime qui caractérise la IIIe République. Le titre L’Ami de l’ordre fait écho à « l’armée de l’ordre »Idem, p. 15 (et au titre L’Ennemi du peuple), à Voltaire vu comme « un homme d’ordre » du côté des « gens éclairés »Idem, p. 19 comme M. Bonhomme qui ne cesse de se répéter dans un discours plein d’autosatisfaction : « Moi, je suis un homme d’ordre, un bourgeois »Idem, p. 20, matérialiste et pragmatique qui « existe par l’argent et pour l’argent »Idem, p. 32. Quant à Thiers, son héros, il est défini comme « l’Homme de l’ordre » et deux fois comme « un grand homme »Idem, p. 19. À ses côtés figurent d’autres personnages historiques (Varlin et Darboy) moins nombreux que dans les pièces du siècle suivant. L’ordre pour le bourgeois est moins une notion politique qu’une préoccupation matérielle et pragmatique sans état d’âme : « Qu’est-ce que je demande ? À faire des affaires ; voilà tout. Je ne tiens pas plus à un gouvernement qu’à un autre. »Idem, p. 20. L’obsession de l’ordre renvoie à la dédicace tout aussi ironique sous la plume de Darien : « Ce drame, évocation d’une époque où les doigts lâches des satisfaits rivèrent le glaive aux mains du bourreau est dédié à Francisque Sarcey, ami de l’ordre et bon homme ». Ce critique dramatique, ainsi désigné par ces surnoms, était connu pour ses écrits contre la Commune. En outre, une déclaration de M. Bonhomme paraphrase le début de la dédicace : « Il faut que le couteau reste rivé aux mains du bourreau !… »Idem, p. 19. La question des relations et des sentiments humains est au centre de ce drame, puisque la réflexion oscille entre l’estime, la sympathie, la peur, l’hostilité, la compassion, l’amour du prochain prôné par la religion et l’amitié que l’aristocrate refuse de donner au prêtreIdem, p. 11.
Les prises de position sont annoncées par l’onomastique avec M. Bonhomme (l’homme bon) du côté de Sarcey et M. de Ronceville (ronce / ville). Ce dernier, hérissé dans sa fierté aristocratique dédaigneuse et rance, hanté par les souvenirs de ses combats, attend vainement le réveil improbable de ses idéaux endormis depuis plus d’un siècle – comme La Belle au bois dormant au château entouré d’épines et de ronces. Ces opinions sont tranchées et sans grande surprise : les partisans de l’ordre sont incarnés par l’aristocrate et le bourgeois voltairien et libre-penseurIdem, p. 15. M. de Ronceville s’inscrit dans la tradition des combats historiques symbolisés par « le vieux fusil dont [il s'est servi] en Vendée et en Italie pour aller combattre les Bleus », fidèle à ses valeurs et ses convictions anciennes selon la formule consacrée : « Je suis partisan du trône et de l’autel. »Idem, p. 10. Dernier témoin de la fin d’un monde sans pour autant avoir l’envergure d’un Chateaubriand ou d’un Don Diègue, il déplore, d’une part, la mort de l’épopée à travers l’énumération de ses combats (« J’ai combattu en Vendée, avec la duchesse de Berry ; j’étais à la Pénissière ; en Italie contre Garibaldi, pour soutenir les Bourbons de Naples ; à Castelfidardo, avec Lamoricière, pour soutenir le Pape. »Idem, p. 10) et, d’autre part, la perte de l’Idéal – pour lui, la justiceIdem,, p. 12 – car « ils n’ont pas seulement coupé la tête d’un roi ; ils ont décapité l’Idéal. Ils en crèveront. » Idem, p. 11, explique-t-il sur le ton de Cassandre. Ses propos résonnent de manière miraculeusement performative, du moins étrangement prophétique : « un de ces bandits, les mains rouges encore de sang, viendrait vous demander asile, que vous le cacheriez chez vous ! »Idem, p. 13. Conscient des changements de l’échiquier (« Vous savez bien qu’il ‘y a plus ni Blancs ni Bleus. ») ou plutôt de la palette politique (« Il n’y a plus que des Rouges – plus ou moins rouges, plus ou moins roses – qui se gourment entre eux. »), il met ses adversaires dans un même panier et n’a cure « de ces combats entre démocs-socs et bourgeois, cette guerre entre l’Une et Indivisible et la Sociale »Idem, p. 10.
Le déséquilibre est flagrant entre les cinq partisans de l’ordre rétabli et l’unique représentante de la Commune, femme rescapée et traquée dont l’arrivée tardive vers la fin de la scène III (didascalie « On sonne et un grand bruit à la porte. »Idem, p. 25) et à la fin de la scène IV (« Marie entre, avec une femme, jeune, échevelée et les vêtements en désordre. »Idem, p. 27) crée un effet de surprise et de retardement, comme la première apparition de Tartuffe puisque, depuis le début de la pièce, on ne parle que d’elle ou plus exactement de ceux de son camp. En effet, alors que les communards sont au centre des conversations et des peurs obsédantes, avec l’arrivée inopinée de cette femme en cavale, c’est le danger extérieur qui fait irruption sur scène si bien que l’objet du discours prudemment mis à distance par la parole conteuse et dénigrante (les « ils » anaphoriques de l’ouverture) finit par s’incarner, doué de parole, de vie et de mouvement. La Pétroleuse devient l’allégorie fugitive de la Commune, du moins de ce qu’il en reste, lointain avatar affaibli de La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Elle fait penser à Léone, l’héroïne communarde de la nouvelle de Cladel « Revanche » L. Cladel, Les Va-nu-pieds, Lemerre, Paris, 1873, qui échappe par miracle aux Versaillais.
Aucune solidarité féminine n’est décelable puisque la bonne Marie obéit avec réticence à L’Abbé qui lui a demandé de cacher l’insurgée (« Mais, monsieur le curé… vraiment… »L’Ami de l’ordre, p. 34). D’après les témoignages des contemporains, les femmes – versaillaises en l’occurrence – étaient les plus féroces dans leur acharnement contre les vaincus « abandonnés aux insultes d’une foule sans cœur »Idem, p. 8. L’Abbé se montre au contraire plus indulgent parce qu’il a affaire à une femme (« Mais vous, qui êtes une femme, et dont l’inconscient me fait pitié »Idem, p. 31). La Pétroleuse est « malheureuse » (« y en a qui sont si heureux et d’autres si malheureux »Idem, p. 30, 31) alors que Varlin est « misérable »Idem, p. 23, ce qui est pire, n’a ni nom ni âge et concentre sur sa personne les caractéristiques qui font d’elle une victime toute désignée : le sexe, l’âge (« Mais nous autres, les jeunes, c’est autre chose qu’on a dans la peau. »Idem, p. 30), le statut social, à savoir celui d’une pauvre femme du peuple et enfin l’action criminelle puisque les incendiaires sont châtiés comme ceux qui ont les mains noires de poudre. La Fantine des Misérables qui est également une réprouvée – son crime étant la prostitution – lui ressemble, hormis la dimension de révolte et l’arrière-plan politique que Hugo laisse de côté en montrant la passivité et le fatalisme du personnage.
Georges Darien joue sur les mythes forgés par les discours politiques et le décalage par rapport à la réalité révélé par la part de fantasme misogyne (« Une pétroleuse !… Une vraie !… Ah ! ça, mais… Il y en a donc des pétroleuses ? »Idem, p. 28) en suggérant que leur création correspond à une invention phobique, fruit de l’imaginaire collectifVoir E. Thomas, Les Pétroleuses, Gallimard, Paris, 1963.. Georges Darien défend la cause de ce personnage que tout condamne en soulignant son manque d’esprit et de conscience morale et politique puisque dans la scène V, elle se contente de répéterJusqu’à trois fois (p. 30). « Non » et « J’sais pas ! » avec obstination. C’est un être « de parole » dans toutes les dimensions de l’expression : pourtant elle est moins fidèle à ses idéaux politiques – si elle en a – qu’elle ne révèle une relative absence d’influence extérieure et de conscience politique ; d’autre part, elle n’existe que par ses discours répétitifs et son entêtement qui constituent son acte de résistance. Darien met l’accent sur son aspect inoffensif, son ignorance et – sans pour autant l’innocenter – sur une culpabilité toute relative qui n’en fait pas une « Vierge rouge » comme Louise Michel ou une cannibale révolutionnaire surgie de 1789 et des années suivantes : « L’exaltation sanguinaire des femmes dépasse celle des hommes qu’elles excitent aux plus abominables cruautés. Elles se grisent d’atrocités. Une folie sadique, une fureur obscène qui trouve dans le cannibalisme le dernier degré de l’abjection […]. » P. de Vallière, Le 10 août 1792 : grandeur helvétique : la défense des Tuileries et la destruction du Régiment des Gardes-Suisses de France à Paris, L’Âge d’Homme, « Poche Suisse », Lausanne, 1992, p. 124. On est loin des Amazones, des Ménades décrites par les témoins de la Commune et de la Révolution française bien que leur souvenir soit encore vivace : « Il me semble voir une de ces tricoteuses qui nous envoyaient si joliment à la guillotine. »L’Ami de l’ordre, p. 33.