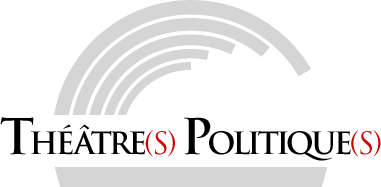L’Esprit communard dans La Saignée, de Lucien Descaves et Fernand Nozière (1913)
le par Nathalie Coutelet
Un mélo communard ?
Le critique du Matin, dans le compte-rendu qu’il publie, annonce qu’on « pourrait s’amuser à conter cette histoire à la façon des drames de l’ancien Ambigu »Guy Launay, « Au théâtre », op. cit.. Le lieu de représentation de La Saignée possède en effet une histoire liée à celle du mélodrame, qui a fait sa réputation : « MM. Hertz et Coquelin ont […] décidé d’abandonner le genre adopté jusqu’ici par l’Ambigu-Comique, et dans lequel s’illustrèrent Les Deux Gosses, Les Deux Orphelines, La Porteuse de Pain et tant d’autres mélos à succès qui firent « pleurer Margot » »Spleen-le-Jeune, « La Presse et le Théâtre », op. cit. Les Deux Gosses, de Pierre Decourcelle, sont un triomphe de l’Ambigu, avec plus de 760 représentations, à partir de février 1896. Les Deux Orphelines, d’Adolphe d’Ennery et Eugène Cormon, viennent d’être reprises à l’Ambigu, en 1911, mais la pièce a été créée en 1874 à la Porte-Saint-Martin. La Porteuse de pain, adaptée du roman de Xavier de Montépin par lui-même, en collaboration avec Jules Dornay, a été créée à l’Ambigu en janvier 1889. « Vive le mélodrame où Margot a pleuré ! » est la citation de Musset la plus couramment reprise lorsqu’il est question du mélo. Voir Florence Fix, Le Mélodrame : la tentation des larmes, Klincksieck, Paris, 2011..
La Saignée est d’emblée présentée par de nombreux articles comme un mélo ou comme une pièce rompant avec la tradition instaurée par l’Ambigu, à cause du thème communard. En fait, tout dépend de l’appréhension des critiques, qui leur fait privilégier l’évocation historique ou l’intrigue familiale et amoureuse. La fiction de la pièce, « le fil qui conduit et relie les divers tableaux »Edmond Stoullig, « La Semaine théâtrale », op. cit., repose essentiellement sur Antonine, personnage central dont on suit l’évolution au travers des événements de la Commune. La jeune ouvrière, apprenant à l’acte I que son fiancé, Charles, est mort à Bazeilles, avoue à ses parents qu’elle est enceinte : « si sûrs du mariage, ils ont eu l’heure de folie classique »Sales, « La Semaine dramatique », op. cit.. Son père, Mulard, tout républicain qu’il est, a des principes rigides et un sens aigu de la morale : « Il déplorait tout à l’heure la corruption de l’Empire ; il met ses actes en accord avec ses paroles : il chasse sa fille »Adolphe Aderer, « Premières Représentations », dans Le Petit Parisien, n°13488, 3 octobre 1913.
Sans ressources, enceinte, celle-ci subit le siège avec de telles difficultés qu’elle se rend, malade, à l’hôpital où travaille Raymond Duprat, étudiant en médecine, et perd son enfant à naître. Son père ne lui pardonnera qu’à l’acte IV, lorsque, face aux événements de la Commune, il prendra conscience que sa mort peut survenir à chaque instant. La fille perdue, réhabilitée par l’amour paternel, constitue un thème dramatique devenu classique.
Et, bien sûr, Raymond tombe amoureux d’Antonine, qui accepte finalement de devenir sa maîtresse. L’histoire pourrait en rester là, avec la perspective d’une « résurrection » comme le dit Antonine (IV, 9), mais Charles, que l’on croyait mort à Bazeilles, est bien vivant : l’acte IV est celui du rebondissement typique du mélodrame. Antonine est alors placée entre deux hommes, le bourgeois qui va lui assurer un avenir confortable et le soldat survivant de l’hécatombe sedanaise, farouche communard. Le triangle amoureux que le public de l’époque connaît bien pour le voir représenté dans une majorité des pièces du boulevard, se complète ici d’une dimension sociale et politique : « Tu ne peux pas l’aimer ! » s’insurge Charles, « On est du même faubourg, de la même graine toi et moi ! On a poussé ensemble ! Lui… C’est du tabac supérieur ! » (IV, 9).
Les arguments avancés par Charles sont uniquement de nature sociale. On retrouve le thème de l’opposition des classes, déjà perceptible en dehors de l’intrigue amoureuse. Le choix d’Antonine ne se fonde pas sur les qualités personnelles de chacun des prétendants, mais sur les valeurs qu’ils défendent : « Je retourne avec les miens » annonce-t-elle à Raymond et, quand ce dernier objecte que sa place n’est pas sur les barricades, elle réplique : « Non ! Mais auprès de ceux qui vont en faire et peut-être mourir dessus ! » (IV, 10). André du Fresnois affirme que cette intrigue mélodramatique aux « revirements brusques qui émeuvent l’âme simple du public » ne brille pas par « le naturel et la vraisemblance », la psychologie féminine étant très éloignée des actions d’AntonineAndré du Fresnois, « Notes de théâtre », op. cit..
Ce « conflit tragique »Adolphe Brisson, « Chronique théâtrale », dans Le Temps, n°19086, 6 octobre 1913 est rapidement résolu par le sentiment de classe et l’urgence de la situation : il faut choisir son camp, versaillais ou communard. Selon Adolphe Brisson, ce conflit n’est pas développé davantage par faute de temps ; il semble plutôt, ainsi que le soulignent d’ailleurs nombre de ses confrères, que « quelque chose transforme et grandit cette action. C’est le cadre où MM. Descaves et Nozière l’ont placée »Guy Launay, « Au théâtre », op. cit., c’est-à-dire la Commune. L’intrigue amoureuse ne serait donc que l’« armature »« Revue dramatique », dans La Nouvelle Revue, op. cit. sur laquelle se greffent les événements historiques. Toutefois, la place prise par l’aspect fictionnel, égale à celle du récit communard, contredit cette analyse du journaliste.
Descaves a connu les représentations mélodramatiques dans son enfance, au Théâtre de Belleville. Il dit en garder « de chers souvenirs », parce qu’il sentait dans ces spectacles, « le cœur ingénu du faubourg ». Tout en affirmant ne pas « raffoler du mélodrame pleurnichard », il apprécie « la qualité de son émotion », « la pitié, l’amour du prochain, la charité, la justice immanente »Lucien Descaves, Souvenirs d’un ours, op. cit., p. 12-13. Par conséquent, certains éléments du mélo peuvent avoir une influence sur un auteur qui cherche à toucher le public et à transmettre une histoire vivante et vibrante.
L’omniprésence des chansons constitue un autre ingrédient indispensable du mélodrame. Antonine, dès l’acte I, apprécie de chanter avec le père Gachette qui l’accompagne au violon. Elle interprète, au grand désespoir de son père, le répertoire de Thérésa, « la diva du ruisseau »« Je suis une fille du peuple, et j’amuse le peuple […]. Moi, après bien des luttes, bien des tourments, j’ai été jetée sur les planches d’un café-concert […]. J’étais seule d’abord comme une naufragée sur une île inconnue. J’ai chanté, et tout Paris est venu à moi. » (Mémoires de Thérésa par elle-même, E. Dentu éditeur, Paris, 1865, p. 3-4)., dont elle devient une sorte de double. La Commune avait été l’occasion pour la vedette de passer d’un répertoire au comique truculent à la chanson réaliste. Dans l’acte III, Antonine chante Le Chemin du Moulin, l’un des titres de ThérésaChanson composée par Darcier en 1864., sur une place de Montmartre. Cette chanson, signe de ralliement familial, est le refrain joué au violon par le père Gachette, au retour d’exil de Mulard.
Antonine, comme Thérésa, est sortie de la rue pour devenir « Antonia », vedette de l’Ambigu. Au 6e tableau, situé en 1880, de retour d’une représentation, elle s’exclame : « J’ai dû leur chanter deux fois La Marseillaise ! » (tableau 6, scène 4). Thérésa, elle, a chanté La Marseillaise à la Gaîté en 1870. Comme elle, Antonine devient « la Muse du peuple de Paris, massacré mais non abattu »« La Saignée », dans L’Humanité, n°3473, 20 octobre 1913. Pour Louis Veuillot, Thérésa est « la Patti du peuple, la Patti de la canaille », pour Laurent Tailhade, la « Melpomène d’estaminet ». Cités par Pierre-Robert Leclercq, Thérésa, la diva du ruisseau, Anne Carrière, Paris, 2006, p. 71.. Toutes deux figurent l’ascension des classes populaires, leur reconnaissance, mais encore la résurgence possible de l’esprit communard. Il n’a pas échappé à Adolphe Brisson« Le dernier acte nous transporte au lendemain de l’amnistie, dans le Paris illuminé par les lampions du 14 juillet. Antonine, actrice populaire, étoile de l’Ambigu (comment cette ascension s’est-elle opérée ? Nous sommes placés devant le fait accompli) ». Adolphe Brisson, « Chronique théâtrale », op. cit. l’absence d’explication sur la célébrité soudaine d’Antonine, que le spectateur quitte, à l’acte V, modeste chanteuse de rue, accompagnée par le père Gachette, pour la retrouver au tableau suivant, neuf ans plus tard, au sommet de la célébrité. La Marseillaise, qui n’est pas encore l’hymne de la France, trouve un statut de chant officiel durant la IIIe République La Chambre des députés vote l’officialisation de La Marseillaise en 1879., après avoir galvanisé les fédérés de la Commune. Descaves a entendu lui-même Thérésa, dont il ne garde guère un souvenir ému, évoquant « son écoulement sentimental », les « leucorrhéiques du couplet »Lucien Descaves, Souvenirs d’un ours, op. cit., p. 60-61. Mais le « personnage Thérésa », en revanche, intéresse l’auteur dramatique au plus haut point. Elle lui permet d’incarner, au travers d’Antonine, cette gouaille populaire qui émerge des faubourgs pour gagner d’autres strates sociales.
Pour le dernier tableau, le décor est celui d’une fête populaire du 14 juillet, avec orchestre de bal et foule en liesse. L’orchestre joue « la polka de Fahrbach : Tout à la joie » (tableau 7, didascalies). Mais la chanson finale est Le Chant du Départ, interprété par le père Gachette, puis repris en chœur par la fouleLe Chant du départ a été composé par Méhul, sur des paroles de Chénier. Le Comité de Salut Public le fait jouer le 14 juillet 1794 pour célébrer l’anniversaire de la prise de la Bastille.. Comme La Marseillaise, cet air est issu de la Révolution française ; comme elle, il exalte le peuple français et son engagement. La majorité des critiques, tels que Maurice Boissard, célèbre la réussite de cette évocation :
Le dernier tableau, peut-être le plus réussi de tous, frappant de vérité, vivant au possible, un bal public […]. Il rappelle, par son animation et sa couleur, ce tableau de Renoir […] : Le Bal au Moulin de la Galette. Tout, la danse, les costumes des danseurs et des danseuses, les lampions autour de l’estrade des musiciens, jusqu’à l’air que joue l’orchestre […] ressuscite à merveille, devant nos yeux, un coin de cette époque.Maurice Boissard, « Théâtre », op. cit. La toile de Renoir date de 1876.
Renoir avait peint Montmartre et ses guinguettes populaires, dans une ambiance proche de celle décrite par la pièce. Le dénouement joyeux, conforme aux fins heureuses du mélodrame où la Providence pourvoit au châtiment des méchants et à la récompense des bons, trouve grâce aux yeux des journalistes : « […] on danse et se trémousse, en 1880, à la fête du 14 juillet. Tout finit par des chansons disait Brid’oison ; ici, tout se finit par des danses ! »Félix Duquesnel, « Les premières », op. cit..
L’évocation du Mariage de Figaro, pièce considérée, a posteriori, comme annonciatrice de la Révolution française, renvoie au rôle que peut jouer le théâtre dans la société – un rôle qu’espère ardemment Descaves. Plus que le « happy end » du mélodrame, ce dénouement en danses et chansons symbolise, certes, « la douceur confiante des fêtes civiques, sur l’apaisement et la réconciliation républicains »Guy Launay, « Au théâtre », op. cit. ; cependant, le discours de Mulard, qui précède directement Le Chant du départ, incite à une analyse encore plus politique. Mulard annonce le réexamen historique de la Commune : « Aux insurgés !… dont j’étais… on a reproché comme un crime de lèse-patrie, leur transport au cerveau. L’avenir les jugera… Sans oublier que ces mauvais patriotes ont tout de même fait entendre la première protestation contre une paix humiliante ! » (tableau 7, scène 3).
Les communards, longtemps considérés comme de mauvais citoyens, seront en effet, plus tard, jugés comme de véritables patriotes. Les toutes dernières phrases prononcées sont celles du Chant du départ : « Le peuple souverain s’avance… Tyrans, descendez au cercueil ! ». Plus que la réconciliation, c’est bien de révolte et de toute-puissance du peuple dont il est question. Sous des allures de périple sentimental d’une héroïne de mélodrame, La Saignée met constamment en scène la Commune mais, surtout, les idéaux communards. La Nouvelle Revue indique que « si la Commune avait besoin d’une réhabilitation, elle trouverait dans la personne et le talent de M. Lucien Descaves un éloquent défenseur »« Revue dramatique », dans La Nouvelle Revue, op. cit.. Non seulement le journal reconnaît ainsi la prépondérance de Descaves dans l’écriture de la pièce, mais encore son ambition de faire le jour sur un épisode que beaucoup de Français veulent taire, y compris dans les rangs des hommes politiques. La Presse relate d’ailleurs que, lors d’une représentation, « un énergumène, la barbe et le cheveu en bataille », cria « à chaque tirade de fédéré : « Vive la Commune ! » »Spleen-le-Jeune, « La Presse et le Théâtre », op. cit.. Au-delà de l’anecdote, ce fait divers révèle la portée communarde de la pièce, qui dépasse les éléments mélodramatiques, que l’on peut percevoir comme une volonté de gagner le public en lui attachant les personnages.