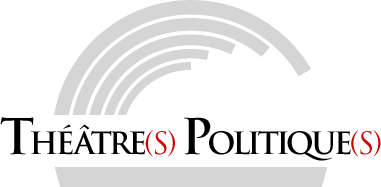Commune de Paris d’André Benedetto (1971) : une lecture en trois temps
le par Philippe Ivernel
III
Le lecteur qui maintenant ouvre la pièce proprement dite, telle que l’a publiée P. J. Oswald en 1971 également, est en droit de trouver approximative et négligente la mention que l’auteur en fait lors de la rencontre strasbourgeoise de 2008 : « J’ai écrit 70 à 100 petites scènes » que, ajoute-t-il, l’« on » n’a pas montées parce que l’« on » s’est contenté du défilé. Cela étant, il apparaît distinctement, à la lecture de cette pièce, que sa structuration d’ensemble répond bien à l’ordre du défilé. Ce dernier reprenait les grandes étapes de la Commune historique, au nombre de trois, en les illustrant par une pancarte et une image. Benedetto les caractérise comme suit dans son récit de l’action de rue :
1 Paris, mars 1971
le peuple refuse de rendre les canons et proclame la Commune
Avignon approuve
derrière cette pancarte vient le canon
2 la commune est une grande femme rouge
qui exprime quelque chose de si fort qu’on la tue et qu’on ne peut pas la tuer
Derrière cette pancarte vient la femme rouge
3 la répression fut terrible en mai, le cadavre de la Commune est à terre, mais l’idée est toujours debout.
Partout
derrière cette pancarte vient le poingA. Benedetto, Commune de Paris, op. cit., p. 17
Un tract – « Grande parade : victoire de la Commune » – redonne ces trois pancartes et images, disposées en diagonale (doc. 3). Plusieurs citations, à l’horizontale, soulignent l’importance de ces mois historiques où :
« […] le prolétariat […] a compris qu’il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en mains ses destinées et d’en assurer le triomphe en s’emparant du pouvoir. » (Le délégué au Journal officiel / 21 mars).
« […] il y a là de quoi griser d’orgueil et de joie l’armée victorieuse des Républicains. » (Jules Vallès / Le Cri du peuple / 28 mars)
« Où étaient leurs grands hommes ? a-t-on dit. Il n’y en avait pas. C’est précisément la puissance de cette révolution d’avoir été par la moyenne et non par quelques cerveaux privilégiés. […] » (Lissagaray)
La pièce et le défilé se répondent, comme déjà dit, en conformant leur déroulé aux trois étapes du mouvement historique nommé Commune de Paris. Soit, banalement, un commencement, un milieu et une fin. Sauf que la fin, ici, va inverser le commencement (au lieu de l’accomplir) et que le milieu paraît, dans l’entre-deux, voué aux contradictions principales et secondaires, d’où résultera le basculement. Rien ne dit néanmoins que les choses en resteront là : « Le cadavre de la Commune est à terre, mais l’idée est toujours debout. ».
La pièce s’inscrit bien dans ce schéma qu’elle partage avec le défilé, de telle sorte, toutefois, qu’elle en multiplie les oscillations dans le détail et, de ce fait, en augmente l’ouverture dans l’ensemble. Les « 70 ou 100 petites scènes » mentionnées par l’auteur semblent fort en dessous de ce que dénombre le lecteur : plus de cent cinquante morceaux, à vrai dire, de toute nature, monologues, dialogues, chœurs parlés, chants et chansons, dires et paroles. Chacun de ces morceaux est assigné à un espace qu’il occupe en propre à lui seul : la page se tourne après chaque morceau, en laissant des blancs qui marquent l’intervalle. L’organisation graphique de l’édition dans son ensemble joue sur les vides autant que sur les pleins, et le discontinu s’affirme comme l’indispensable correctif des enchaînements mécaniques. Aussi bien, les pages produisent l’effet de feuilles volantes, détachables en tout cas, certaines pouvant servir de tracts s’il le fallait. Leur assemblage compose alors une mosaïque, sans doute, mais non une fresque dans laquelle se fondraient les morceaux. Ce mode de composition suggère ou souligne la variabilité tant de la représentation que de la chose représentée. Il relève d’une primauté du montage sur la conception organiciste de l’œuvre d’art, qui tend à se clore sur elle-même comme une totalité intouchable.
Ce principe du montage, il affiche sa libre loi tout au long de la pièce, à travers un jeu d’affinités, de ruptures ou de contrastes entre les « petites scènes ». Tout ce qui est alors réuni, dans un cadre d’intelligibilité certes solide, « délivre des multiplicités de relations qu’il est impossible de réduire à une synthèse ». Le système étant alors capable « de se modifier devant chaque nouveauté, chaque exception, chaque singularité, chaque excès, donc un système extensible au risque de se montrer interminable ». Ce sont les termes dans lesquels Georges Didi-Huberman commente le principe de montage au travail dans l’Atlas mnémosyne de Warburg. Non sans citer, après ce dernier, Eisenstein se référant à Dionysos personnifiant le phénomène originaire du montage « dans la mesure où, mis en morceaux, démembré, fragmenté, il ne se transforme pas moins en une créature rythmique, « épiphanique », une créature qui renaît de toute coupe et qui danse en dépit de l’agôn (le conflit), du pathos (la souffrance) et du thrènos (la lamentation) »Voir Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet – L’Œil de l’Histoire 3, Les Éditions de Minuit, Paris, 2011, p. 115-116.
Le hasard ou la nécessité veulent que le couple dialectique mort/renaissance influe non seulement sur la loi formelle du théâtre de montage, dans la pièce de Benedetto, mais aussi sur la substance historique dont elle est censée rendre compte. Cela vaut pour le cadre de référence – cheminement, proclamation et disparition de la Commune de Paris –, mais plus encore, peut-être, pour les nombreuses petites scènes de rue, où s’exprime l’existence quotidienne des anonymes, individus, groupes et masses représentant, comme Lissagaray l’écrit, la moyenne, sans que le lecteur sache exactement ce qui relève là de la fiction ou du factuel. Peu importe au fond, si l’on estime que la Commune reste toujours à inventer.
Les dialogues de rue, qui sont pléthore ici, donnent l’impression d’instantanés fixés par une caméra invisible. Ils font entendre le discours de l’immédiateté, qui n’est pas forcément le moins chargé de signes. À travers ces échanges de répliques dont les porteurs ne sont pas nommés – si bien que leur identité inquiète le lecteur, le met en mouvement – passent débats et combats, l’écart entre vie privée et vie publique se comble. Et les conversations quotidiennes peuvent renvoyer aux assemblées officielles de la Commune de Paris, où s’expérimente principalement la démocratie en marche. Là se noue la problématique dans laquelle se rejoignent l’hier et l’aujourd’hui : c’est l’idée de République qui se trouve mise à l’épreuve, entre la bourgeoise et la sociale, prises l’une et l’autre dans un double processus de construction et de déconstruction. Un regard jeté plus précisément sur le début et sur la fin de texte – pour ne pas avoir à en traverser l’épaisseur – permet de prendre la mesure concrète de ce qui se joue dans la forme et dans le contenu.
Les premiers morceaux qui s’offrent à la lecture ont pour caractéristique de multiplier les angles d’attaque : sur le plan politique, sur le plan existentiel, sur le plan théâtral. D’abord la question politique : elle est introduite par une citation de Friedrich Engels, assimilant la Commune de Paris à la dictature du prolétariat ; cette citation se voit reprise et variée par un bref échange de propos entre Karl et Friedrich :
Regardez la Commune de Paris !
Quel est ce sphinx qui tracasse si fort l’entendement bourgeois ?
C’était la dictature du prolétariat !A. Benedetto, Commune de Paris, op. cit., p. 23
Puis la même notion passe dans une autre bouche :
Oui, mais combien incomplète et fragile !
Il leur manquait un chef.Idem, p. 24
Comme c’est un certain Joseph qui tranche ainsi, le lecteur n’est pas prêt à lui accorder confiance. Ainsi la triple variation aboutit-elle à un retournement de la question.
Sur le plan existentiel, dira-t-on, le morceau suivant, intitulé « C’est », énumère les aspects inépuisables d’un jaillissement de sensations, d’énergies et de conceptions :
un chatoiement
un éparpillement
une pulvérisation
un feu d’artifices
une gerbe d’étincelles
une brassée de fleurs
une poignée de sable
une giclée de parfum
une nuée d’oiseaux
un torrent de paroles
[…]
une myriade d’orgasmes
un état d’ivresse
une femme rouge
une fête la vie
une folie la viela fête du pouvoir
le pouvoir de la fête
soixante-douze jours qui é-branlèrent
la conscienceIdem, p. 25-26
Puis :
actions simultanées
entremêlées
faites et refaites
successives
une naît l’autre meurt : un feu
le mouvement perpétuel dans l’espace éclaté si le théâtre est une ville éternelle !Idem, p. 26
La dramaturgie de la pièce Commune de Paris se trouve manifestement indiquée à travers la multiplicité des actions qui ne se laissent pas intégrer dans un temps homogène et continu. Et si l’on cherche maintenant l’espace approprié à leur présentation, c’est apparemment le théâtre de tréteaux qui fournit le modèle :
une grappe humaine sur des tréteaux qui s’ouvre et se referme
[…]
Une masse en mouvement qui prend les figures les plus diverses, qui se forme et se déforme et se reforme selon les scènes
[…]
une formidable naissance sur quelques planches devant des badauds au soleilIdem, p. 29
Soit encore : « une société toute neuve en gestation » Idem. Cela étant, le morceau qui vient aussitôt après rompt le charme fort de l’utopie en convoquant, devant les citoyens, l’Escogriffe : celui-ci fait surgir la menace de « la bande à Riquiqui », une chanson de Jean-Baptiste Clément :
Bien qu’on nous dise en République
Qui tient encore comme autrefois
La finance et la politique
Les hauts grades les bons emplois
Qui s’enrichit et fait ripaille
Qui met le peuple sur la paille
C’est qui ?Toujours la bande à Riquiqui !Idem, p. 30
Riquiqui c’est dans un vaudeville de 1806, M. Rikiki ou le voyage à Sceaux, le nom d’un personnage prétentieux, ridicule et niais. Plus généralement, il connote la mesquinerie, l’avarice et l’étroitesse. Il s’incarne ici dans le personnage bien réel de Thiers, ayant la fièvre de l’ordre, appuyé sur la famille, la propriété, la religion. Il tient dès le début de la pièce un monologue où il se découvre tel qu’en lui-même :
Moi Adolphe Thiers
J’ai traité avec Bismarck par-dessus la tête des Jules
J’ai laissé pourrir la situation à Paris
J’ai mis un terme à la guerre à outrance et brisé toute tentative de résistance nationale
[…]
Devenu chef du pouvoir exécutif par l’Assemblée de Bordeaux
J’ai pris des mesures énergiques qui sont autant de provocations à l’émeuteIdem, p. 33
Ce Rikiki-là et sa bande représentent le pouvoir dominant, soit, en termes théoriques, la contradiction principale. Thiers est dans la pièce, face à la Commune, un personnage sans fissure, de toutes parts cuirassé. Il sait ce qu’il veut, il fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait : « La saignée, pour une bonne vingtaine d’années ». Or la saignée, comme on sait, aura bien lieu : ce qui confirme le personnage dans son essence. Il revient en force dans la dernière partie de la pièce, à l’heure du massacre, dans un discours de vainqueur s’adressant à la « majorité silencieuse et satisfaite », pour dire la loi, et le reste.
Quand sonne l’heure de la « guerre révolutionnaire », l’auteur de Commune de Paris évoque les combats de barricades, ultime sursaut, par un ou deux de ces instantanés dont il cultive la technique. On sait qu’il préfère le fragment incisif au regard qui embrasse tout. Aussitôt après, il laisse un chœur de communards tirer la leçon des événements, coupant court à l’émotion pour miser sur la lucidité. Ce chœur énumère comme suit les erreurs commises :
Nous nous dressons sur des barricades d’erreurs […]
Nous n’avons pas poursuivi Thiers !
Nous n’avons pas pris la Banque !
Nous n’avons pas eu d’organisation !Idem, p. 157-158
La liste ne s’arrête pas là et touche à des questions déjà remuées au cours de la pièce. Benedetto ne fait là que reprendre, à vrai dire, un faisceau de conclusions établies de longue date dans une partie du mouvement ouvrier. Mais il s’empresse en même temps de relativiser leur portée en confirmant l’exemplarité de la Commune au plan le plus élevé :
Et l’erreur la plus grande, la plus grande de toutes, ils nous la feront payer cher. […] D’avoir voulu inscrire l’homme au beau milieu de l’univers comme une bête responsable, grande, si grande que tout le sang versé ne l’effacera pas.Idem, p. 157
La formule de l’École des Beaux-Arts, au verso de la couverture du livre qu’on sait,
nous
serons tous
fusillés
mais
nous
nous en foutons
apparaît dans le corps du texte immédiatement après l’énumération des erreurs commises.
Dans la partie qui s’ensuit, les massacres de la Semaine sanglante occupent beaucoup de place : une gageure, car on serait en droit de juger qu’ils excèdent les limites de la représentation. De nouveau, la tâche d’illustrer les exécutions en série est confiée à de « petites scènes » et non à quelque grande vision apocalyptique. Étroitement cadrées, elles procèdent cas par cas, en pointant la singularité de chaque mort au sein du meurtre de masse : l’enfer, aussi bien, est dans le détail. Chacune des exécutions suivantes, par exemple, comporte une charge de dramaticité qui lui est propre :
Je t’ai vu sur la barricade !
Moi ?
Au mur !
Avance !
Qui es-tu ?
Lévêque, ouvrier maçon.
C’est maçon et ça veut gouverner ! Au mur !
Et celui-là ?
Que criais-tu ?
Vive la Commune !
Au mur !
Vive la Commune !Idem, p. 159
Chacune de ces morts, ponctuée par le même « Au mur ! » à répétition, affecte différemment la sensibilité et stimule différemment la pensée. Il en va de même, c’est-à-dire encore différemment, de l’exécution de Raoul Rigault et d’Eugène Varlin, dont l’histoire a conservé la mémoire, à côté de l’exécution d’anonymes, dont l’implication dans le mouvement populaire est plus ou moins prononcée. Il suffit d’une simple présence dans la rue ; un enfant, un médecin, un fédéré : « Fusillez-les ensemble » ; celui-là voulait se sauver : « On va le fusiller. ». Comble de tout :
Enterrez !
Oh regarde, une main sort de terre !
Comme une taupe !
Fusillez la terre !Idem, p. 182
La série des exécutions est entremêlée, significativement, c’est-à-dire une fois de plus contradictoirement, des fragments d’un discours et d’une chanson : le discours de Thiers guide de la contre-révolution triomphant sous les noms de l’ordre, de la justice et de la civilisation, et la chanson de Pottier au refrain insistant : « Tout ça n’empêche pas, Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte. ». Composée en 1885 sur un air à la mode, la chanson rappelle en substance que, selon un slogan bien plus récent, « la lutte continue », alors que « la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte ». Pour achever ce montage, et avec lui la pièce, il y a l’image d’une Madame Gentil ne fermant pas sa porte le soir parce qu’elle attend toujours celui qui n’est pas rentré : « C’était hier. Il n’y a que cinq ans. ». Sur la page qui fait face à cette « petite scène », un commentateur :
C’était hier
Il n’y a que cinq ans
C’était hier
il n’y a que vingt ans
C’était hier
il n’y a que cent ans
Il reste encore à supprimer l’état
Il reste encore à supprimer la propriété
Il reste encore à supprimer l’exploitation
C’était hier
Il n’y a que cent ansIdem, p. 189
1871/1971 : en cette année 1971, la brèche de mai 68 ne s’est ouverte qu’il y a trois ans. Ne s’est fermée qu’il y a trois ans.
Tournons la page. Un nouveau texte se présente : six pages denses, compactes, d’une longue méditation entreprise par un « je » qui ne dit pas son nom (et relayée par d’autres éventuellement) sur le mur (des Fusillés pour commencer) et les murs (en tous genres pour continuer). Le mot lui-même, « mur », revient plus de cent vingt fois, dans les contextes les plus divers. Les souvenirs du passé se mélangent à l’enfermement du présent. C’est le retour obsessif des divisions, des séparations, des enceintes : la ville est un mur et le théâtre dans la ville en est un autre. Mais il s’agit toujours de sauter les murs, ou d’y « créer un trou ». S’ensuit alors une liste de propositions qui n’en finit pas, puisque, dernier mot de l’affaire, confiée au public :
c’est une liste à compléter
non c’est une liste à refaire
c’est une page blanche
ci-contreIdem, p. 196