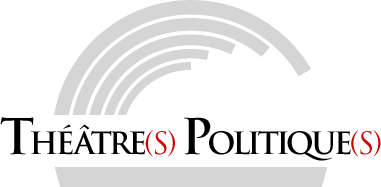Travailler sur scène – Journée d’études (14 février 2008)
le par theatres-politiques
Résumé
Présentation générale Partons de ce constat d’Anne Ubersfeld : Le travail […] est non seulement une activité sociale, mais il s’insère dans un procès social. A ce titre il est rarement présent sur une scène de théâtre, où il ne pourrait apparaître que marginal, éliminant l’un des traits distinctifs de l’activité-travail quelle qu’en soit la [...]
Présentation générale
Partons de ce constat d’Anne Ubersfeld :
Le travail […] est non seulement une activité sociale, mais il s’insère dans un procès social. A ce titre il est rarement présent sur une scène de théâtre, où il ne pourrait apparaître que marginal, éliminant l’un des traits distinctifs de l’activité-travail quelle qu’en soit la nature, la durée. Le travail humain est ce que le théâtre ne peut guère iconiser, parce que la production sociale est ce qui ne peut s’imiter et que le travail du temps ne saurait apparaître scéniquement.Anne Ubersfeld, « L’objet théâtral et l’activité humaine : le travail », dans Anne Ubersfeld, L’Objet théâtral. Diversité des significations et langages de l’objet théâtral dans la mise en scène contemporaine, Actualité des arts plastiques, n°40, CNDP, 1977, p. 43
Si nous choisissons de privilégier le verbe sur le substantif, c’est précisément pour mettre en valeur cette dimension processuelle de « l’activité-travail » et distinguer son apparition théâtrale en tant que thème et son apparition en tant que procès, angle sous lequel le travail apparaît particulièrement rétif à la représentation.
Le travail serait-il la pierre d’achoppement de la mimésis ? Déjà en son temps, Louis-Sébastien Mercier cherchait pourtant à convaincre de l’intérêt qu’aurait le spectacle inédit de la navette, du marteau et de l’équerreLouis-Sébastien Mercier, Du Théâtre ou nouvel essai sur l’art dramatique, chap. 9 : « Et si nous descendons aux conditions, que de choses curieuses à apprendre ! Combien la navette, le marteau, la balance, l’équerre, le quart de cercle, le ciseau, mettent de diversité dans cet intérêt, qui au premier coup d’œil semble uniforme. Quoi ! On lira avec ravissement la description technique des métiers, et l’homme qui spécule, qui conduit, qui invente ces machines ingénieuses, ne serait pas intéressant ? Cette diversité prodigieuse d’industrie, de vues, de raisonnement, me paraîtra cent fois plus piquante que les fadaises de ces marquis que l’on nous donne comme les seuls hommes qui aient une existence, et qui malgré leur bavardage n’ont pas la centième partie de l’esprit que possède cet honnête artisan. Qu’on ne dise donc plus la carrière est fermée. On n’y a fait encore que les premiers pas : on s’est fréquemment égaré dans le choix des sujets, on n’a point saisi les plus beaux, les plus convenables, les plus utiles. Le poète, semblable à cet astrologue dont la vue était perpétuellement attachée aux étoiles du firmament, n’a point vu ce qui est à ses pieds ; il est temps de lui crier avec un fabuliste moderne : que faites-vous dans l’empirée ? Les malheureux sont sur la terre ! ».. Encore s’agissait-il essentiellement de désavouer les préjugés aristocratiques de la nomenclature théâtrale classique pour mettre en valeur les âmes nobles que secrète indistinctement chaque condition. Du travail du vinaigrier, nous ne voyons que le fruit (le « baril » qui contient toute une vie d’économie et qui permettra de marier le fils de Dominique et la fille de M. Delomer) et le totem (la fameuse « brouette » qui donne son titre à la pièce et dont la seule apparition sur scène se donne déjà comme l’indice d’une transgression suprême de toutes les « convenances » en vigueurVoir Louis-Sébastien Mercier, La Brouette du vinaigrier, acte III : « (Le Théâtre représente une espèce de Salle par bas ; Dominique père en bonnet de laine et en veste rouge, conduit un petit baril sur une Brouette de Vinaigrier à une roue, laquelle est à bras. Il entre sur la scène en roulant sa Brouette : un Domestique veut s’y opposer.) » – ainsi des objections du Domestique, scène 1 (« Qu’est-ce que cela veut dire ? on n’a jamais vu pareille chose ; et certainement vous êtes fou »), puis de celles de Dominique Fils (« Qu’est-ce donc, mon père ? Qu’avez-vous donc ? Comme vous venez ici ! Eh mon Dieu ! que voulez-vous avec tout ce train ci ? […] Vous choisissez bien votre temps, et encore mieux le lieu. […] Quoi ! cet habit de travail, ce Baril, cette Brouette dans une Salle frottée ! […] Vous avez résolu de m’éprouver, mon père ; mais j’ai peur que vous ne manquiez aux convenances reçues dans le monde… »).). Le travail fait ses premières incursions sur les scènes en tant qu’état et que valeur mais son procès continue d’être esquivé – « Comme si l’oisiveté était une des conditions pour être un personnage de théâtre. Comme s’il fallait avoir le temps d’être un personnage de théâtre », ironise VinaverMichel Vinaver, « Théâtre et champ du travail », entretien avec Jacques-François Marchandise, Écrits sur le théâtre, vol. 2, L’Arche, Paris, 1998, p. 220. À terme, il conviendra d’étayer cette histoire du discrédit et de la réhabilitation du travail comme enjeu et comme objet de la représentation, en distinguant des époques-charnières, mais aussi en tâchant de confronter l’évolution du théâtre français avec des cultures et des traditions peut-être moins tributaires de la hiérarchie classique des genres et des styles..
C’est donc aux pièces et aux spectacles qui réservent une place à l’activité laborieuse, à ses coordonnées spatiales et temporelles, aux gestes, aux objets et aux discours qu’elle induit, qu’il s’agit de s’intéresser. De quelle activité s’agit-il ? Comment est-elle donnée à voir sur la scène ? Avec quel degré de vérisme ou de stylisation ? de familiarité ou d’étrangeté ? Quels rapports se créent dès lors entre ce qui se fait et ce qui se dit ? entre l’activité laborieuse et l’action dramatique, sachant que l’une et l’autre se déroulent selon des règles spécifiques, sinon radicalement hétérogènes ? Quelles sont les fonctions de telles séquences ? Ont-elles une visée pédagogique ? spectaculaire ? dénonciatrice ? glorificatrice ? Ce questionnement concerne notamment les pièces de théâtre dont les didascalies mentionnent explicitement une telle activité et cherchent à construire de véritables « tableaux » (ce qui nécessite un important travail de repérage, tant ces occurrences peuvent paraître rares) ; il concerne plus encore la mise en scène et les différents dispositifs qu’elle met en œuvre : ses effets de réel (du tableau pittoresque qui sert de simple toile de fond à la reconstitution documentaire qui ancre les personnages dans un milieu), d’historicisation (ainsi des mises en scène brechtiennes des classiques, comme celle de George Dandin par Planchon, où le spectacle des travaux agricoles cherche à remettre la pièce de Molière « sur ses pieds » et souligne les rapports de force qui fondent les déboires du paysan parvenu avec la noblesse désargentée à laquelle appartiennent les Sotenville), de contrepoint (on pense ici aux « intermèdes usiniers » des Marchands et à la façon dont ils mettent à distance le discours de la narratrice), de détournement, burlesque, poétique ou fantastique (par exemple, dans Les Étourdis par Deschamps et Makeïeff)Autrement dit, le corpus des spectacles comprend non seulement des créations collectives et des représentations de pièces qui s’inscrivent explicitement dans le monde du travail, mais aussi des mises en scène qui, malgré la pièce, choisissent de mettre le travail à l’honneur, pour recontextualiser le propos, en signaler les procédures de refoulement et de dénégation, ou créer des connexions inédites entre texte et image. Dans cette perspective, qu’en est-il par exemple du spectacle Maeterlinck monté par Christoph Marthaler ? Quels sont les enjeux de cette collision entre les textes de Maeterlinck et le quotidien d’un atelier de couture ?…
Ceci étant posé, on remarque d’ores et déjà qu’il est assez délicat d’établir une distinction franche entre la représentation directe et la représentation indirecte du travail. Que dire en effet des scènes en atelier de Loin d’Hagondange dont l’intérêt réside précisément dans la façon dont elles convoquent les coordonnées du faire usinier pour souligner leur intrusion dans la vie de retraité de Georges ? Que dire de la tirade du Père qui, dans Usinage, décrit son travail dans ses moindres détails jusqu’à en restituer le rythme propre ? Prenant acte des résistances que le travail à la chaîne oppose à la représentation, ces modes de figuration ne méritent-ils pas d’être intégrés à l’analyse, en tant qu’ils continuent d’envisager l’activité-travail dans le rapport étroit qu’elle noue avec le corps, l’espace et le temps ? Du reste, les occurrences problématiques risquent d’abonder dès lors que l’on quitte le monde ouvrier pour celui des employés, des cadres, voire des dirigeants de l’économie mondialisée : travaillent-ils ou parlent-ils de leur travail ? S’agissant de transactions commerciales et boursières ou encore de la direction des ressources humaines, il est intéressant de cerner les nouveaux défis que ces activités adressent à la représentation et de voir par quels moyens et par quels détours le théâtre s’efforce d’incarner ce capitalisme dit « immatériel » qui ne cesse pourtant d’avoir des effets extrêmement concrets.
L’objectif serait que chacun, d’une part, contribue à la constitution d’un corpus de textes et de spectacles en apportant quelques références précises, d’autre part, puisse intervenir sur la base d’un exemple à exposer et à analyser. Outre l’axe de recherche qui nous occupe ici, l’enjeu, à plus long terme, est de constituer une base bibliographique et documentaire conséquente (incluant iconographie, vidéos et paratextes de dramaturges ou de metteurs en scène) et, sur cette base commune, de mettre en place un certain nombre de critères permettant de mettre de l’ordre dans ce matériau profusÀ titre de pistes : critères historiques (non seulement par siècle, mais aussi par « moment » : 1917, 1936, 1968…), esthétiques (naturalisme, constructivisme, brechtisme…), thématiques (la grève, les conditions de travail, les conditions de vie), socio-professionnels (ouvriers, cadres, patrons / secteur primaire, secondaire, tertiaire), politiques (théâtre militant ou non), critères liés au mode de production-création (qui joue ? pour qui ? à quel stade et selon quelles modalités y a-t-il rencontre entre théâtre et monde du travail ?)..
Interventions
• Armelle Talbot, « Travailler sur scène : enjeux théoriques et historiques (repérages) »
• Odile Krakovitch, « Les Ouvriers dans le théâtre de la Monarchie de Juillet et du Second Empire ».
• Marjorie Gaudemer, « L’Incompatibilité scénique du travail et de la parole dans le théâtre ouvrier, en France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle »
• Bérénice Hamidi-Kim, « Le Travail, parenthèse ou maillon dramaturgique, scénique et social ? Étude du spectacle Les Marchands de Joël Pommerat »
• Marine Bachelot et Léonor Delaunay, « La Représentation du travail ouvrier dans Sortie d’Usine de Nicolas Bonneau »