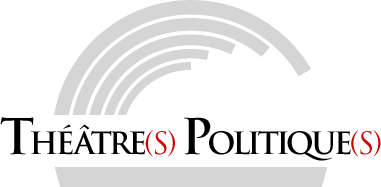Quand le cinéma s’empare d’un évènement révolutionnaire pour discuter la question de l’engagement – La Commune (Paris, 1871) de Peter Watkins
le par Émilie Chehilita
Rôle et improvisation, ou comment passé et présent, reconstitution historique et contemporain se mêlent
La première séquence est la réunion préparatoire de l’Union des femmes (U.D.F.) le 18 mai 1871 que les participantes ont choisi de jouer en l’absence des hommes. La seconde, entrecoupée d’une émission de la télévision versaillaise, d’une discussion dans la salle d’école laïque et d’une lettre de Mme Talbot, montre le journaliste de la télévision communale, désolidarisé de sa collègue, qui pose des questions sur l’engagement des participants alors dans leurs rôles de communards, derrière leurs barricades, tandis que les forces versaillaises marchent sur Paris.
Le principe d’ambiguïté dans les œuvres de Peter Watkins
La scène de l’Union des femmes est introduite par la pancarte suivante :
18 mai. L’Union des femmes tient une réunion préparatoire pour constituer des Chambres fédérales et syndicales de travailleuses. Elles conviennent de se réunir à nouveau le 21 mai. Mais cette réunion, qui aurait pu être essentielle pour l’avenir du développement social et politique des femmes, n’aura jamais lieu.P. Watkins, La Commune (Paris, 1871), op. cit., 2e partie, début du plan : 1:50:23
Les femmes sont présentées dans un plan d’ensemble ; assises sur de grands sacs de blé en toile de jute, le cadre coupe certaines têtes ou membres de manière aléatoire. La qualité argentique rend le grain de l’image visible et lui confère une matérialité, une densité, un caractère palpable. Les robes plutôt amples et les coiffures peu soignées des femmes leur donnent l’apparence de femmes du peuple à la fin du XIXe siècle. Seules les manières de s’exprimer – le vocabulaire, l’articulation et le ton – sont contemporaines. Le travail d’une esthétique « réaliste » au travers des costumes et du noir et blanc confère une authenticité à l’image, et la fait ressembler par moments à s’y méprendre à une archive. La sobriété, le direct, l’aspect rugueux de l’image, les réajustements de la lumière au milieu des prises, le cadre qui coupe sans cesse les têtes posent un principe d’ambiguïté : on ne sait s’il s’agit d’un documentaire ou d’une fiction. Ce souhait de dérouter le spectateur au point qu’il ne sache pas si ce qu’il voit est réel ou fictionnel est une constante dans l’œuvre de Peter Watkins : en témoigne la réaction d’une partie du public britannique à la sortie de The War Game (La Bombe) en 1965 qui crut à sa réalité, trouble similaire à celui que produisit la lecture radiophonique de The War of the worlds (La Guerre des mondes) de H. G. Wells par Orson Welles le 30 octobre 1938. Antoine de Baecque résume cette impression toujours renouvelée face aux productions du cinéaste :
En regardant un film de Peter Watkins, le spectateur se trouve placé devant une représentation de l’histoire dont il ne sait si elle semble vraie parce qu’elle est fausse, si elle se voudrait vraie alors qu’elle est fausse, ou si elle apparaît fausse pour mieux dire la vérité.A. De Baecque, op. cit., p. 235
Les trois pistes que propose Antoine de Baecque envisagent tous les questionnements possibles quant à la véracité ou la facticité des témoignages, des discours, de l’agencement des faits. Le plus étonnant est de ressentir que malgré le nombre d’éléments allant dans le sens d’une interprétation contraire, une impression d’authenticité persiste. On entend bien que nombre d’interprètes s’expriment comme dans la rue, dans une langue et une facture actuelles ; on sait bien qu’il est impossible qu’un film d’actualités ait été tourné en 1871 ; cependant, toutes ces restrictions n’empêchent pas le sentiment d’une grande vérité des paroles et des actes. Les deux appréhensions de l’objet sont rendues étranges, la réception oscille entre l’une et l’autre, et ce vacillement constant est signe de l’étrangeté de l’objet et de son saisissement. Il s’agit déjà là d’une forme de réalisation du Verfremdungseffekt (effet d’étrangeté) brechtien. Le film rend la spontanéité étrange, l’Histoire, étrange : on ne peut pas se fier aux acteurs non-professionnels qui peuvent sembler sincères en toute naïveté, non plus qu’aux acteurs peut-être professionnels qui imitent à s’y méprendre les personnages historiques – si tant est qu’il soit possible de les distinguer sans erreurL’homme qui joue le rôle du président Thiers est particulièrement convaincant, on aurait pu penser qu’il faisait partie des acteurs professionnels : il n’en est rien..
Le spectateur se familiarise petit à petit avec cette énonciation d’un genre rare, la progression du film est pensée de telle sorte qu’à sa fin apparaissent le plus de parallèles entre passé et présent et que les adresses se fassent en majorité au temps de l’énonciation.
La séquence de l’Union des femmes, une réflexion sur l’engagement
Alors que ces femmes avaient justement expliqué la violence qui pouvait naître de l’isolement face à la caméra, de l’impossibilité de s’adresser à son partenaire en le regardant dans les yeux, elles sont ici filmées en un grand plan d’ensemble dans un rapport entièrement frontal, comme pour une photographie de groupe. Les regards ne sont pas tous orientés vers la caméra, certaines scrutent un point invisible, d’autres ont les yeux perdus dans le vide, d’autres encore se retournent légèrement afin de voir celle qui parle. Une cartographie complexe des regards se crée.
Tantôt amicaux, tantôt sévères, le plus souvent concentrés, les regards révèlent des personnes fatiguées, mais sur le qui-vive, à l’écoute : on sent que le groupe prête attention à celle qui souhaite prendre la parole. Les échanges, pour la plupart sous la forme de discours monologiques, se font presque sans heurt ; une fois seulement, deux voix se chevauchent. Certains corps sont avachis et, comme dans les regards, on y lit de l’épuisement. Le corps collectif n’est pas homogène, chaque individualité ressort, chacun se fait juge, les regards-caméra sont décidés, nourris. La fatigue, qui doit être celle de la fin du tournage, et l’engagement à simplement être-là donnent à chacune une présence. Le spectateur a l’impression d’une coprésence, comme au théâtre. Antoine de Baecque éprouve la même sensation :
[…] les visages nous regardent, les paroles nous interpellent, les costumes retrouvent leur qualité de vêtement, la posture des corps ne porte plus le poids du passé tout en semblant le recréer, le plan est habité par un étrange effet de présence.Antoine De Baecque, op. cit., p. 234-235
Peter Watkins capte l’éphémère de ce que l’on pourrait nommer au cinéma une « sur-présence ». Les personnes sont surinvesties en comparaison de l’interprétation moins en force que demande en général le cinéma, par rapport au théâtre. La frontalité de l’ensemble ajoute à cet aspect théâtral de la mise en scène cinématographique.
Il est surprenant de remarquer que les femmes semblent s’adresser à la caméra et donc au spectateur, voire au réalisateur, plus qu’aux camarades à leurs côtés. Le point de départ de cet extrait est le moment où l’interprète se déclare en tant que telle et souhaite expliquer sa place au sein du processus filmique. C’est un des rares moments où le spectateur peut être sûr que l’interprète s’exprime de sa propre voix. Hormis à l’ouverture lorsque les journalistes de la fictionnelle télévision communale présentent les décors, les interprètes sont constamment, on l’a déjà noté, dans une relation ambiguë à leur « personnage », pris dans un jeu d’aller-retour entre le passé et le présent. Ici, la décision de parler de l’engagement en tant que comédien lors de la création et militant au dehors n’empêche pas le parallèle avec et la réflexion sur l’Histoire.
Alors, moi je voudrais parler du travail que je suis en train de faire avec Peter sur le film de la Commune […] il nous a fallu à travers tout un groupe à trouver notre démocratie pour pouvoir avancer durant ce processus, laisser la place aux autres, pouvoir prendre la sienne, et puis je trouvais qu’il y avait un parallélisme avec la Commune parce que je pense que ça a été très, très difficile, parce que c’est difficile d’être démocrate quand il y a des désirs très forts, quand les gens sont poussés par des énergies d’espérance, et que la foule rend les choses difficiles à atteindre profondément et dans ce film, on avait parfois cette joie qui partait comme ça et on partait avec, et quelques déceptions qui nous faisaient retomber et rechercher notre place, j’ai trouvé ça très, très passionnant. Voilà. (léger sourire de la femme, regard caméra nourri)Transcription d’un extrait de la séquence de l’Union des femmes, dans P. Watkins, La Commune (Paris, 1871), op. cit., 2e partie, début et fin de la séquence : 1:50:54 – 1:52:59
La réalisation du film a été vécue comme une expérience collective démocratique et a mené à une émancipation collective qui transparaît dans le montage final. Dans leurs chairs, les « participants » ont vécu l’événement, l’une des femmes l’explique : « C’est quand même une expérience pleine d’espoir et, en ça, c’est quand même très positif. Il faudrait essayer de diffuser largement non seulement le film, mais aussi le vécu qu’il y a eu autour de ce film. ». La création de l’association Rebonds pour la Commune en vue de diffuser le film trouve ici son historique. Peter Watkins profite de cette remarque sur la future circulation de l’objet artistique pour glisser après ces paroles trois pancartes sur la télévision et le cinéma états-uniens et questionne l’impérialisme culturel de ce pays :
[1re pancarte] La première industrie exportatrice aux États-Unis n’est ni l’aéronautique, ni l’informatique, ni l’automobile, mais le secteur du divertissement : les films et les émissions de TV. La « petite fenêtre ouverte sur le monde » assure un relais omniprésent : le nombre de TV par habitant a quasiment doublé entre 1980 et 1995.
[2e pancarte] En 20 ans, la part des recettes d’Hollywood provenant de l’étranger est passée de 30 à 50 %.
En 1996, l’industrie cinématographique US détenait 76 % du marché européen et 83% du marché latino-américain.
Les films étrangers aux USA représentent moins de 3 % du marché.
[3e pancarte] Je ne veux pas que ma maison soit entourée de murs de toutes parts, je ne veux pas que mes fenêtres soient obturées. Je veux que les cultures de tous les pays puissent circuler chez moi aussi librement que possible. Mais je refuse d’être écrasé par l’une d’entre elles. Gandhi.P. Watkins, La Commune (Paris, 1871), op. cit., 2e partie, début et fin de la séquence : 1:55:06 – 1:56:00
En parallèle à l’engagement des femmes, l’indéfectible combat de Peter Watkins contre l’uniformité médiatique, contre la mainmise d’Hollywood sur l’esthétique cinématographique mondiale, ressort. Et, au-delà, c’est la question du saisissement des représentations par les personnes représentées, de l’action des personnes représentées sur les représentations que le cinéaste propose ici de leurs corps et de leurs voix en tant que rôles et personnes. Une femme interpelle les autres et se dit interloquée par le fait qu’elles n’aient pas encore trouvé le « déclic », la lutte qu’elles aimeraient mener :
Moi, c’est la cause des sans-papiers qui m’a fait réagir parce que quand tu parles d’affrontements aujourd’hui… le mois dernier, on s’est fait virer de la place Vendôme par les C.R.S. de manière relativement… (elle s’interrompt puis reprend) vraiment violente, parce qu’en fait, ils avaient enlevé leurs casques et leurs boucliers, donc c’étaient des hommes comme nous […] Moi, c’est ce qui m’étonne chez vous, c’est que moi j’ai l’impression d’avoir trouvé ou, en tout cas, qu’il y a eu un déclic qui a fait que je me suis engagée, encore une fois, je n’étais pas née avec, mais, j’avais des choses qui me tenaient à cœur comme le respect de l’autre, comme l’accueil, la tolérance, l’ouverture, la diversité des cultures […] Encore une fois, c’est cette question de se battre avec soi-même, sur cette fameuse barricade et savoir quelles sont ses limites, mais quelles sont ses envies aussi et peut-être aussi savoir demander de l’aide aux autres pour qu’ils nous aident aussi à franchir ces fameuses barricades.P. WATKINS, La Commune (Paris, 1871), op. cit., 2e partie, début et fin de la séquence : 1:56:39 – 1:59:14
Cette femme interpelle franchement ses camarades et touche aussi, par leur intermédiaire, le spectateur. Le lien entre les interventions n’est pas clair, la conversation n’a pas pour objet un thème précis, l’ensemble est chaotique et plein de digressions et on n’apprend rien dans ce court extrait sur l’Histoire de la Commune. C’est pourquoi ce film porte tout autant sur l’engagement que sur la révolution communarde, sur la difficulté de l’organisation lors d’un processus révolutionnaire que sur la révolution de la Commune à proprement parler. Une des paroles prononcées dans cette séquence pourrait servir de conclusion à tout le film : « Pour tout le monde de toute façon, il est temps qu’on ne soit pas représenté, mais qu’on soit. »Ibid., 1:52:41 – 1:52:45.
Le film dialectise l’habituelle dichotomie entre action et réflexion, mouvement et parole au travers notamment de la direction d’acteurs. Le réalisateur demande aux « participants » d’être capables d’alterner avec le plus de virtuosité possible entre immersion physique et distance réflexive. Lors d’une des grandes discussions collectives au café, une des interprètes qui s’est d’abord exprimée sur l’enseignement de l’Histoire au lycée, la répétition inlassable d’un même regard sur le passé – notamment l’omission de la révolution de la Commune soulevée à plusieurs reprises dans le film – et l’impossibilité de saisir le présent, revient ensuite sur la dichotomie entre faire et dire :
Je m’aperçois que par exemple sur ce film, il y a un grand décalage entre la réflexion et l’action et le fait d’être mis en place dans une situation qui est par exemple : « On est sur les barricades » et on est complètement, physiquement impliqué dans une lutte directe et forte et chimique, physique. Dès que la caméra arrive et qu’il faut que la parole sorte de là, on a un rapport très difficile, on a un rapport très difficile à ce que la réflexion soit en relation avec l’action et je trouve que le vrai changement possible, il est vraiment dans ce travail-là, il est vraiment… et il est pas dans une démission de « Oui, mais de toute façon, on sait très bien comment ça va se passer, de toute façon, c’est dur parce qu’on n’arrive pas à se réunir en collectif », mais il est vraiment, vraiment, profondément dans une recherche sur comment c’est possible d’être plus en relation avec ce qu’on pense, avec ce qu’on peut dire, avec les idées. Se battre, si on ne veut plus se battre physiquement, violemment, il faut continuer de se battre sur les idées et comment les défendre physiquement, ces idées.Ibid., 53:44 – 54:47
L’expérience de la séparation ou du décalage entre action et réflexion, engagement physique et théorique ainsi que l’essai de lier les deux, est en partie la prise de conscience que Bertolt Brecht souhaitait chez son spectateur, chez son acteur et en particulier chez son acteur lorsqu’amateur, il participait au Lehrstück (pièce d’apprentissage). Les interprètes apprennent et transmettent leur apprentissage.
L’importance peu courante donnée au discours des femmes dans ce film souligne le parti pris de Peter Watkins selon lequel les femmes seraient l’âme de la CommuneEntretien avec J. Gatti, op. cit. : « Son point de vue, je pense que si on avait à dire où il se situait, à quoi il s’identifiait dans le film, c’est les femmes de l’Union des femmes. Pour lui, c’est ça, l’âme de la Commune. Je te dis ce qu’il exprimait, je ne te dis pas qu’après ça se ressent dans le film, mais pour lui, c’est ça, l’âme de la Commune. […] Pour moi, c’était même très clair, ça se ressentait sur le plateau, sur la façon dont il s’adressait à elles, l’attention qu’il avait à la parole qu’il leur donnait, etcetera, après, je ne me souviens plus si sur le film, c’est si clair que ça. Mais, même l’affiche, c’est une femme. ». Le réalisateur rend un très bel hommage aux femmes et ceci n’est pas un anachronisme car elles ont été très actives durant la Commune qui a été le lieu de véritables avancées pour le droit des femmes, comme ce qui est de l’égalité des salaires par exemple. À l’écoute des revendications des femmes au sein du processus créatif comme de l’Histoire, Peter Watkins réalise un film empreint d’un féminisme d’une grande finesse. Si le militant est mis en avant, c’est avant tout avec subtilité.
L’intervalle entre la reconstitution historique et l’action au présent est criant dans une des dernières plongées épiques de la caméra parmi les combattants.
La caméra derrière les barricades, les participants face à leurs barricades
D’une trentaine de minutes, le passage durant lequel la caméra longe l’arrière des barricades, guidée surtout par les déplacements du journaliste, Gérard Bourlet, rend un effet proche du cinéma direct – trait caractéristique du style de Peter Watkins, déjà évoqué en amont. La caméra tenue à l’épaule se tourne avec une remarquable vélocité d’un interlocuteur à l’autre, se fraye un chemin parmi la foule grouillante, donnant à l’ensemble cet aspect de documentaire. Il ne s’agit pas d’un unique plan séquence, mais les passages semblent avoir été tournés au cœur de plans séquences et montés par la suite : l’impression d’une continuité demeure. Outre les interrogations sur la situation de jeu telle que « Qu’est-ce que vous faites en ce moment ? », le journaliste s’entête à poser des questions comme : « Et vous, vous y seriez allés à cette époque-là ? », « Tu serais prêt à refaire des choses comme ça ? Tu serais prêt à faire ça ? ». De courts échanges se nouent entre le journaliste et des gardes nationaux :
- Un homme d’une cinquantaine d’années : J’en pense quoi ? De toute façon, on n’a plus rien à perdre. Le peuple n’a plus rien à perdre, il est prêt à mourir, c’est tout, c’est la liberté ou la mort et seule la force garantira la liberté, c’est Blanqui qui a dit ça.
– Gérard Bourlet : Et vous personnellement ?
– Le même : C’est Blanqui qui a dit ça.
– G.B. : Vous, pas Blanqui, vous !
– Le même : Moi, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Je ne sais pas, je suis un littéraire, un romantique, je ne sais pas si je l’aurais fait aujourd’hui. Je crois que le pouvoir a changé, le pouvoir est outre-Atlantique, le pouvoir est économique maintenant et alors, il faut se battre autrement, il est au plan culturel, il est au plan économique.
– Un autre homme d’une quarantaine d’années : Maintenant, c’est l’argent, c’est ça le pouvoir maintenant, l’argent. On juge les gens en fonction de ce qu’ils gagnent, pas de ce qu’ils sont. C’est l’argent, point. Aujourd’hui, mais avant, c’était pas ça.
– Un homme d’une trentaine d’années : Tu as tort, jamais la force n’a garanti la liberté, jamais, jamais, jamais. Dans toutes les expériences passées, jamais la force n’a garanti la liberté, au contraire.Ibid., 2e partie, 2:11:11 – 2:11:58
Il est étonnant de remarquer que, même dans la précipitation, les personnes interrogées gardent une distance par rapport à l’action dans laquelle elles sont engagées. Certes, la plupart font une réponse en accord avec leurs actes et disent qu’elles auraient mené le combat en 1871 et qu’elles le mèneront à l’avenir, mais cette première assertion à brûle-pourpoint débouche sur de riches débats. La question est de celles auxquelles on ne peut pas répondre ; pourtant, les échanges ne sont pas dénués d’intérêt. Dans la citation juste en amont, le journaliste interdit à l’interviewé de parler au nom d’Auguste Blanqui (1805-1881), révolutionnaire français et républicain socialiste, et le force à donner son propre avis. Celui-ci arrive à déjouer un peu la question avant de répondre qu’il est incapable de se prononcer et que la lutte aujourd’hui doit se faire en priorité sur deux fronts : l’économique et le culturel. À plusieurs reprises dans le film, il est fait référence au poids du système économique capitaliste néo-libéral et à la difficulté de lui opposer une attaque efficace. Plus loin dans les discussions, des femmes font état de l’opacification des clivages politiques à la fin des années 1990 :
- Une femme d’une trentaine d’années : J’ai peur, moi, j’ai peur maintenant parce que je ne sais pas où ils sont nos ennemis, maintenant. Je ne sais pas, je ne les vois pas.
– Une autre femme d’une trentaine d’années (acquiesçant) : Voilà, le problème, c’est que nos ennemis on ne les connaît plus, on ne sait plus où ils sont, ils sont partout. Le problème c’est qu’aujourd’hui, il y a l’impossibilité de fabriquer ce genre de barricades, il faut se battre contre les médias, il faut se servir des mêmes armes ; les ordinateurs, Internet, la télévision, c’est le putain de moment, c’est maintenant.P. Watkins, La Commune (Paris, 1871), op. cit., 2e partie, 2:26:24 – 2:26:42
Désormais habitués à la méthode de Peter Watkins, les acteurs parviennent, sur le vif, à prendre un peu de recul, même si c’est pour user de références anachroniques. Au tout début de la séquence, un homme âgé explique qu’il était sur les barricades à la Libération de Paris en 1944 et qu’il y retournerait aujourd’hui pour ses enfants. Au sujet de la nécessité de l’emploi de la violence, un homme argue que la question était la même pour les résistants en France face à l’occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Un autre estime que si les combats avaient été plus féroces en mai 1968, les manifestants auraient obtenu des acquis plus solides et durables. Le télescopage des références crée un vaste pot-pourri très approximatif au regard de l’Histoire, mais révélateur d’un point de vue militant. Ces événements ont en commun avec la Commune d’avoir marqué profondément l’histoire des luttes populaires. Plus loin, une femme interprétant Marguerite Lachaise, cantinière au 66e bataillon de la Garde nationale, vient d’haranguer la foule en criant à la traîtrise au visage de Charles de Beaufort, capitaine dans la Garde nationale et aristocrate, soupçonné d’être infidèle à la Commune. L’interprète explique que l’homme avait été jugé innocent par la cour martiale, mais que Marguerite Lachaise avait cru en toute bonne foi à sa culpabilité et ne s’était rendu compte de son innocence qu’après son exécution. Gérard Bourlet lui demande ce qu’elle pense personnellement de ce qu’elle vient de jouer. Elle se prononce en son nom contre une exécution sommaire de ce genre. Le dédoublement entre la personne et le personnage est exposé crûment. Cette femme se lance ensuite dans une diatribe sur la violence au sein des luttes politiques et ouvre sur des questionnements contemporains :
Marguerite Lachaise : […] J’crois que le problème, c’est ça, c’est la colère, la violence, où ça mène ? Où ça va ? Qu’est-ce qu’on peut faire une fois que les gens sont en colère ? Comment arrêter une colère ? Comment arrêter la violence ? Et des violences à l’heure actuelle, il y en a des quantités, il y a la violence économique, il y a des pays entiers, des continents entiers comme l’Afrique qui s’en vont à la dérive au nom d’une économie mondiale qui les sacrifie complètement, il y a, il y a… dans nos pays, tout près de chez nous, tout le monde le sait, il y a des exclusions de toutes sortes ; les sans-travail, il y en a beaucoup, parmi nous, il y a les sans-domicile, et puis il y a les immigrés en situation irrégulière qu’on veut envoyer où, faire quoi ? et ça c’est une catastrophe et, et, et, bon encore plus banal, il y a tous les exclus de la vie sociale, ceux qui habitent dans des cités qui sont des catastrophes humaines et qui n’ont plus qu’une chose à faire contre cette violence, c’est eux-mêmes répondre par une violence physique, mais une violence physique interindividuelle, ils vont faire des larcins et ça monte, ça monte, ça monte et jusqu’où ça va aller ça ? Jusqu’où ? Qu’est-ce qu’on peut faire ? Qu’est-ce qu’on peut faire ?Ibid., 2e partie, 2:18:56 – 2:20:02
Cette ouverture sur le contemporain et notamment sur des batailles conduites par plusieurs des « participants » en faveur des droits des sans-papiers, chômeurs et précaires, est typique du film. Deux femmes se tiennent à côté de celle qui joue M. Lachaise, l’une se ronge les ongles, l’autre a la bouche entrouverte, toutes deux semblent très attentives et, au mot « exclusion », la première pointe la seconde du pouce.
Cette séquence est très bruyante : on entend des roulements de tambour, des coups de feu, des chants choraux au loin, ce qui oblige les interprètes à hausser la voix, les amenant parfois à crier. Sur les visages, sur certaines expressions crispées, dans le ton – vindicatif, pathétique, etc. –, au travers de grands gestes énergiques qui ponctuent les paroles, se lisent la virulence et la rage ou la forte indignation qu’il faut pour livrer une bataille politique. En amont, on avait déjà fait état de la peinture de l’homme de gauche qui pouvait parfois servir pleinement les clichés, entre autres parce que Peter Watkins choisissait de ne pas polir l’image des militants de gauche et d’extrême-gauche. Ici, c’est effectivement une rage qui est criée, expulsée. Le film s’en fait le réceptacle. Cette succession de propos très enflammés peut effrayer le spectateur, ou en tout cas, le laisser dans une position de retrait, se protégeant de tous ces passionnés de la politique. Ce caractère vif et violent engagera sans doute plutôt des effets tranchés chez le spectateur. Il est possible que le film ait plutôt deux effets inverses : laisser le spectateur en distance, le pousser dans ses retranchements ou lui donner l’espoir, l’envie de combattre, lui communiquer cette rage. En amont déjà, par sa longueur, le film peut aussi endormir ou simplement rebuter à l’avance. Si l’on s’applique à le regarder, deux éléments semblent, au-delà d’une réaction de retrait ou d’adhésion du spectateur, transmis de manière très pédagogue : d’une part, l’utilisation de l’histoire de la Commune comme matériel didactique pour la transmission d’une mémoire et d’une intelligence des luttes populaires, et, d’autre part, l’uniformité et l’unilatéralité des flux médiatiques, la nécessité pour être libre et avoir une action sur le monde, de créer ses propres images, deux positions que résument bien les interventions suivantes :
Femme d’une quarantaine d’années : Et si on n’allait pas se battre, c’est comme si on mourait à soi-même et que la Commune on l’emmène avec nous sur les barricades, c’est notre choix et notre liberté, grâce à ça. C’est ça que je voulais dire. C’est tout, je voulais juste dire ça, c’est tout. […]
Femme d’une vingtaine d’années : Pour vivre, il faut lâcher votre micro, il faut vous battre avec nous, pour des utopies, il y a encore des utopies à défendre aujourd’hui.
(Elle pointe son fusil en direction de la caméra.)
Alors, donnez votre micro à tout le monde, lâchez-le !Ibid., 2e partie, 2:26:44 – 2:28:12