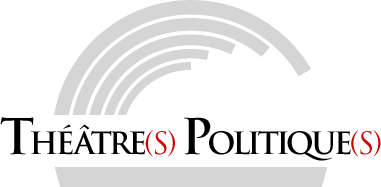« Mais l’idée est debout » – Une pièce contemporaine sur la Commune
le par Sandra Coulaud
Pages : 1 2
Concernant l’esthétique de la pièce, vous avez évité le côté spectaculaire de l’effusion de sang qui était pourtant une des possibilités pour représenter la Semaine sanglante. Était-ce un choix de votre part dès le début ?
C’est venu assez tôt. Le danger de ce genre de chose, c’est le côté spectaculaire. Cela peut être très bien mais ce n’est, je pense, pas facile. Cela peut très vite être grandiloquent. Il suffit de se référer un peu aux grands tableaux des révolutions : on y voit toujours ces effusions. Mais, est-ce que cela marche bien au théâtre ? Je ne suis pas sûr. Le choix de faire raconter la Semaine sanglante par une seule personne dans une pièce où ils sont vingt-deux personnages permettait de créer un contraste. Et en écoutant ce bonhomme qui s’est retrouvé malgré lui embringué dans cette Semaine sanglante, échappant à des dénonciations ou à des exécutions sommaires, cela permettait d’avoir une représentation assez effrayante, sans avoir des scènes trop explicites. Du point de vue esthétique et théâtral, c’est un vrai choix.
C’est frappant car, depuis plusieurs années, on assiste au retour d’une esthétique sanglante qui sollicite le public de manière très intense sur le plan émotionnel. Est-ce que ce choix de ne pas proposer un spectacle très sanglant est une manière de respecter l’événement ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c’est beaucoup plus une volonté artistique. Au théâtre, ce qu’on montre n’est pas forcément le plus intéressant. C’est en général ce qu’on suggère qui marche bien. Bien sûr, le théâtre est visuel, mais pour la Semaine sanglante, chacun peut, par ce récit, se représenter les images et l’horreur que cela a pu être sans que cela soit imposé« BOULANGER – Attends ! Commissaire, les communards ont tué des dizaines d’otages, des hommes d’église, des gendarmes ! Leurs femmes ont allumé des incendies partout. Les Tuileries et l’Hôtel de ville sont en flammes ! Et vous approuvez ça ! Vous approuvez ça !
DESSOURCET – Vous marchez dans du sang. Celui de cette pauvre fille que nous appelions Louise, celui de ce jeune homme dont je n’ai jamais su le nom, celui d’Élisabeth. Connaissiez-vous Élisabeth, Boulanger ? Non, bien sûr, comment auriez-vous pu la tuer autrement ? De la racaille, hein ? Eh bien si ça me dit d’en être ! D’être de ceux qui voulaient ne plus crier « Vive l’empereur » avec une baïonnette dans le dos ! Saviez-vous que chaque ouvrier de France avait sa fiche à la préfecture, Boulanger ? Le beau pays que nous sommes, vraiment ! » (M. Bléger – H. Masnyou, L’Affaire d’un printemps 1871, la Commune de Paris, éd. Art et comédie, 1999, p. 116-117). Car le seul moment un peu violent que l’on voit est bref : c’est lors de l’assaut du « Chat qui parle » (doc. 3). Dans la représentation, cela doit durer quinze secondes. On a des coups de feu, on voit des soldats surgir, on voit des corps tomber. C’est violent, mais on n’a pas le temps de s’appesantir dessus. Cela vient juste après le récit de cette Semaine sanglante. On est au bout de cette semaine-là. On sait ce qui va arriver car on est dans le dernier carré des barricades ; les Versaillais arrivent. Un des fédérés arrive même en disant « voilà, on est les derniers ». On attend l’assaut qui arrive, mais c’est vraiment terminé. C’est aussi là pour frapper un peu les esprits. Car tous ces gens que l’on a vus buvant, riant, déconnant dans le bar, se retrouvent tout d’un coup morts au sol.
Vous avez choisi de ne pas mettre en scène des figures historiques connues et de jouer avec la tranche de vie naturaliste (doc. 4) ?
C’est la grande question de cette représentation effectivement. Si on décidait de prendre des figures historiques, on était, de fait, prisonniers d’une réalité que l’on ne pouvait pas modeler comme on le veut. Non pas qu’on change l’Histoire, mais on était obligés de respecter ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont dit. Il y a tellement de connaisseurs, des exégètes de la Commune, qu’on ne pouvait pas faire une pièce où Vallès et Louise Michel ne font pas ce qu’ils auraient dû faire. Donc, on a décidé de ne pas prendre ces personnages et d’en créer. Ils sont tous inventés, sauf un, le préfet Duval, qui lors de son discours au balcon de l’Hôtel de ville prononce un discours qu’il a réellement écrit. C’est le seul personnage historique. On reconnaît sans mal le journaliste qu’on peut identifier à Jules Vallès. On peut facilement identifier Élisabeth à Louise Michel. Mais ce ne sont pas ces personnages-là, ce qui nous laisse une marge de manœuvre plus importante pour la construction du récit. On en parle de ces personnages historiques. Les personnages de la pièce évoquent certains d’entre eux, mais on ne les voit pas.
Dans la construction de la crédibilité des personnages que vous mettez en scène, il y a un travail sur le lexique, mais vous ne semblez pas avoir multiplié les termes pittoresques.
C’est l’autre difficulté, comme pour les décors. On voulait parler de la Commune sans l’enfermer dans un musée. L’idée, au fond, était de montrer que ce qui s’est passé là est un moment de l’Histoire qui continue. Cette volonté de justice, d’essayer de transformer la société dans une certaine direction, ce n’est pas mort. Cela existe toujours. Le mouvement révolutionnaire, le mouvement ouvrier, existe. Il s’est transformé, il a évolué. L’environnement change, mais les idées restent. On ne voulait pas montrer la Commune comme quelque chose d’épisodique et d’enfermé dans une époque comme un point d’orgue. Donc, on ne voulait clairement pas prendre un langage d’époque même s’il y a deux trois petites choses. Ce n’était pas le but. Le but était d’être dans le langage actuel. C’est la même chose pour les décors. On les a complètement stylisés. Le bar avait une ligne lumineuse en pourtour. On ne cherchait pas du tout à être dans un réalisme d’époque. Par contre, on a laissé les costumes d’époque. Mais, et avec le texte et avec les décors, on cherchait plutôt l’intemporalité.
Est-ce que, avec Martial Bléger, vous vous êtes servis de la littérature de l’époque, sans nécessairement que les oeuvres constituent des sources pour un travail de réécriture ? Aviez-vous certains textes en tête pour composer ?
Non, les seuls auteurs que l’on a lus sont, évidemment, Lissagaray et quelques autres bouquins qui racontaient les procès. On avait l’idée, le projet. À partir du moment où on ne voulait pas écrire avec le langage de 1800, on ne s’est pas plus plongés que cela dans des auteurs. C’était plutôt de la recherche historique car on peut toujours faire un contresens historique sur un détail. Par exemple, on parlait à un moment de la gentiane dans le bar. On a modifié la réplique car on s’est rendu compte que cela n’existait pas en 1882, ce qu’on nous a fait remarquer un jour. C’est anecdotique bien sûr, mais en dehors de cela, on a fait des lectures historiques. Par contre, on a consulté des livres de photos pour imaginer les personnages. Il en existe quelques-uns.
Comme matériau historique, vous êtes allés voir des archives, ou encore des journaux ?
Oui, car quand on a eu l’idée du projet, en 1996, cela correspondait aux 125 ans de la Commune. Il y avait une présentation de tous les films sur la Commune à la Bibliothèque de la Ville de Paris. On est allés voir à peu près tout. On s’est aussi servis des archives du Musée de la police où on a justement trouvé le discours de Duval. Puis, on s’est servis des mains-courantes de l’époque où on voyait ce qui se passait. On est allés aussi, évidemment, au Musée d’arts et d’histoire de Saint-Denis, où on a vu des affiches d’époque et d’autres documents en partie d’origine qui nous ont inspirés pour recréer une ambiance ou aborder un certain nombre de thèmes.
Est-ce qu’il y a des dramaturges ou des metteurs en scène dont le travail vous intéresse tout particulièrement, sans que cela ait une incidence immédiate sur ce que vous écrivez ?
Je vais vous dire sans grande originalité VitezAntoine Vitez (1930-1990) fut un grand metteur en scène français de théâtre., c’est sûr. Personnellement, mon premier choc au théâtre a été de voir une pièce de Vitez. Cela a dû sans doute influencer la suite. C’est vraiment difficile comme question car les influences sont vraiment multiples. Par rapport à la construction des personnages, Martial et moi, on aime bien Tchékhov Anton Tchékhov (1860-1904) fut un dramaturge russe qui a marqué le XXe siècle, auteur notamment de La Mouette (1896), d’Oncle Vania (1897) et de La Cerisaie (1904).. On aime le fait de construire des pièces où il ne se passe rien, mais où on comprend petit à petit l’histoire de chacun des personnages, leurs envies, leurs enjeux, tout ce qui est caché. C’est sans doute l’un des maîtres en la matière. Cela a très certainement influé sur le travail de construction des personnages. Pour la réalisation et la mise en scène, c’est plus par opposition que par affinités. C’est-à-dire que l’on refuse assez vite le trop démonstratif, clairement. On est plutôt en réaction à cela. J’aime aussi le théâtre de BondEdward Bond, né en 1934, est un dramaturge anglais marqué par l’esthétique de Brecht.. FrançonAlain Françon, né en 1946, est un auteur et un metteur en scène français. avait fait de très belles choses avec son théâtre et je me souviens d’avoir réellement apprécié. Je dirais que je suis venu à la mise en scène un peu par dépit, car j’ai travaillé avec certains metteurs en scène qui étaient des metteurs en place mais pas des directeurs d’acteurs et je ne trouve pas cela intéressant. Heureusement, j’ai beaucoup travaillé avec Michel VinaverMichel Vinaver, né en 1927, est un auteur dramatique français. : c’est vraiment un bonheur de travailler avec quelqu’un comme lui. Dans mon travail de metteur en scène, j’ai une idée en tête de ce à quoi je veux arriver, de l’ambiance, mais la construction se fait vraiment avec ce qu’amènent les comédiens. C’est donc un travail long, mais qui aboutit à un résultat plus stable. Les gens sont plus à même de s’approprier les rôles. J’opposerais vraiment metteur en scène et metteur en place. Là, nous avons fait un casting pour des personnalités. On savait que l’on avait besoin de tant de personnages. Mais quand on a fait le casting, on n’avait pas du tout envie de dire untel fera ceci, untel cela. On savait qu’ils voulaient participer. On a retenu plus de gens qu’il n’en fallait au début. On a passé un mois complet sur des improvisations, des textes, des exercices. À partir de là, on a pu proposer des rôles en fonction de ce qui convenait à des personnalités. On a vraiment construit petit à petit. Typiquement, on n’a pas fait de casting à la gueule. La seule chose qu’il faut un peu respecter, ce sont les cohérences par rapport à l’âge, mais il y avait suffisamment de monde. En gros, quatre-vingt personnes nous ont répondu. On en a retenu trente-trois et finalement, vingt-deux ont joué.
Vous avez aussi travaillé à deux, avec Martial Bléger, sur la mise en scène et la direction d’acteurs ?
Sur la mise en scène, oui. La direction d’acteurs était plus ma partie. L’écriture finale des dialogues était plus la partie de Martial. On s’est complétés. Par contre, on a discuté ensemble de la construction et de l’organisation des tableaux.
Vous avez parlé du récit dans la pièce. Avez-vous toujours pensé vous exprimer dans le théâtre ou la question du genre s’est-elle posée ? Auriez-vous pu choisir un autre genre que le théâtre ?
Oui. D’ailleurs, lorsque la première version du texte a été terminée, on nous avait dit que cela ressemblait vraiment à un scénario de film, voire d’une série. C’est évidemment encore beaucoup plus difficile d’arriver à monter cela de manière audiovisuelle. Surtout que l’on nous avait dit que c’était un sujet très délicat, avec la Guerre d’Algérie. Si on a un metteur en scène très connu ou un acteur très connu, c’est regardé. Cela a évolué pour la Guerre d’Algérie, mais pas encore pour la Commune. Cela peut encore être monté en film. Mais je trouve qu’il y a une valeur ajoutée à voir des acteurs de chairs incarner des rôles, et que l’on ne trouve pas cela ailleurs, vraiment.
Avant d’écrire, êtes-vous allés voir des pièces sur la Commune ? En avez-vous lues qui aient arrêté votre attention ?
On a lu Brecht B. Brecht, Les Jours de la Commune [Die Tage der Commune], 1949 [Théâtre complet, L’Arche, vol. 6, 2005]. Je ne sais pas si Martial en a vu ou lu d’autres. On a aussi vu la pièce d’Adamov A. Adamov, Le Printemps 71, Gallimard, Paris, 1961. Puis, on a vu la pièce de la compagnie Jolie Môme. Mais c’est vrai que c’est venu après.
Vous ne vouliez pas être enfermés par la vision des autres ?
Oui. On ne voulait pas être influencés par un style, ou par la focalisation sur une période.
Est-ce que cette réalisation va donner lieu à d’autres projets d’écriture ?
Ce serait bien qu’il y ait d’autres projets d’écriture. Moi, j’ai très envie de travailler sur le discours politique à différentes époques pour montrer une certaine permanence dans le discours, en partant de Robespierre, de la Révolution, jusqu’à aujourd’hui. J’ai travaillé dessus avec mon groupe de théâtre et cela répond plutôt bien. Je crois qu’il y a là des choses à construire. Là aussi, il faut essayer de trouver un fil conducteur qui transcende les époques pour montrer une forme de permanence.
Deux personnages féminins sont importants dans la pièce : Élisabeth et Orianne. Vous semblez avoir davantage mis en avant le personnage d’Orianne. C’est elle qui est le plus vulnérable et qui fait remonter à la surface la mémoire de la Commune. Avez-vous hésité un moment entre ces deux personnages ?
Non. C’est Orianne qui à la fin de la pièce prend le relais de l’Histoire et la raconte quand le carnet s’arrête le 27 ou 28 mai. Elle donne ensuite son journal intime qu’elle connaît par cœur à Maxime. C’est vingt-cinq ans de période historique survolée jusqu’en 1896. L’idée était de montrer que cette période historique n’est pas close. C’est Hugo qui disait que « le cadavre est à terre et [que] l’idée est debout »« Le cadavre est à terre et l’idée est debout » dans La Voix de Guernesey – Victor Hugo à Garibaldi, Bruxelles, 1867, p. 14.. C’est un peu cette idée que nous avions avec le personnage d’Orianne. Après, dans les choix esthétiques, c’est quelqu’un qui a disparu dès le début, le 18 mars, mais sur scène elle est tout le temps présente. Elle n’intervient pas, mais on la voit tout le temps. Chaque scène intermédiaire, avec Maxime qui lit le carnet, se passe dans l’un des endroits que l’on vient de voir. Cela symbolise d’une certaine façon la chambre dans laquelle elle est enfermée. Elle ne parle pas, sinon à la fin, pour nous visuellement, juste après le massacre du « Chat qui parle ». Elle ne parle donc que vingt-cinq ans après, pour montrer la continuité de cette idée. C’est, au fond, le personnage dont on parle le plus. D’ailleurs, comme elle ne parle qu’à la fin, cela avait fait beaucoup d’effet sur un public de collégiens devant qui on avait joué. C’était très étonnant. Beaucoup en ont ensuite parlé dans un travail réalisé avec leur professeur. Cela les a fait s’interroger.
Était-ce une façon de montrer le réveil d’une mémoire refoulée ?
Oui, cette chose qui ne sort pas. C’est comme en psychanalyse, il y a l’événement, puis le bouchon saute. Orianne entend une chronique précise des événements lue par Maxime, événements qu’elle n’a pas connus car elle a tout de suite disparu. Quand elle entend le récit du massacre, elle est conduite à reprendre la parole.
Était-ce aussi une façon de montrer que cette mémoire parcellaire pouvait être unifiée dans la pièce ? Il manque des morceaux de cette mémoire à certains personnages qui peuvent peut-être la retrouver complète en se rencontrant ?
Cette perspective n’était pas consciente, mais c’est une lecture que l’on peut avoir.
Bibliographie
Bléger Martial – Masnyou Hervé, L’Affaire d’un printemps – 1871, la Commune de Paris, Éditions Art et Comédie, Paris 1999.
site du spectacle L’Affaire d’un printemps monté par Martial Bléger et Hervé Masnyou [consulté en août 2012]
Pages : 1 2