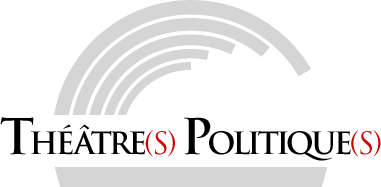La Commune « marouflée » dans Paris : d’Ernest Pignon-Ernest à Raspouteam (1971, 2011)
le par Audrey Olivetti
Se réapproprier la mémoire et la ville
Le street art est un art de la déambulation, de la découverte, de la déviation. Il appelle. Il interpelle. Il provoque. Il extirpe le passant de l’espace codifié et normé que certains veulent faire de la rue. Il fait front à la violence de ces artères transformées en énièmes vitrines pour potentiels consommateurs. Il s’immisce dans les failles qui lézardent les murs et appelle à renverser le regard prisonnier de la quotidiannité. Pour ceux qui le font et ceux qui le reçoivent, il crée un attachement particulier à la ville. C’est avec cette idée-là que je cherche à conclure cet entretien. Qu’ils soient ou non parisiens, quel rapport ont ces artistes avec Paris ?
Ernest Pignon-Ernest répond en évoquant son travail sur Desnos et son appréhension de la capitale à travers les poètes. Mais, en 1971, habitant alors à Nice, il ne connaissait rien de Paris, à peine pouvait-il situer le Père Lachaise. Ce sont donc les fantômes de la Commune qui l’ont guidé à la découverte de la ville. C’est cette recherche de l’invisible dissimulé dans les murs qui le conduit et cette démarche se retrouvera dans le reste de son œuvre, notamment celle qu’il a réalisée à Naples, à Alger ou à Soweto.
Je travaille sur des villes, elles sont mon vrai matériau ; je m’en saisis pour leurs formes, pour leurs couleurs, mais aussi pour ce qui ne se voit pas, leur passé, les souvenirs qui les hantent.E. Pignon-Ernest, cité dans la Préface de Paul Veyne dans Élisabeth Couturier, Ernest Pignon-Ernest, Hersher, Paris, 1991, p. 8
Pour les membres de Raspouteam, parisiens d’origine, il s’agit peut-être plus d’une réappropriation. Et pourtant, le travail de recherche historique les a amenés à ré-appréhender l’espace de la capitale et à découvrir des lieux jusque-là inconnus. En cela, leur démarche se rapproche de celle de leur aîné. Par ailleurs, nous rappelle Matéo, Raspouteam s’inscrit dans une pratique, celle du graff, et en ce sens, peu importe la ville finalement. L’idée plus générale intrinsèque à cet art est de « réinvestir les lieux du quotidien » en leur redonnant « un sens dans le temps, un sens politique [...] un sens qui [leur] correspond ». Ainsi, comme d’autres moments de l’histoire de Paris, ville chargée d’un grand passé de luttes sociales et politiques, la Commune se fait porte d’entrée pour « se réapproprier » des lieux de vie dans une volonté de faire résonner les murs dans le temps présent et de s’opposer à la représentation qui domine les imaginaires, en l’occurrence celle de Paris « Ville lumière », ainsi qu’à la réalité dont provient cette représentation. Les palais et les beaux quartiers sont généralement le fait des vainqueurs. Se dessine alors dans ce projet une possibilité de contrer la gentrification que subit une partie de la population : pour résister à la dépossession des lieux dont elle est la cible, faire resurgir du passé la mémoire des luttes qui sont nées dans ces lieux peut permettre aux habitants du temps présent d’y puiser la force de se battre.
Ainsi se joue véritablement la dialectique du visible et de l’invisible des lieux, dialectique qui rejoint celle de la mémoire. C’est là où apparaît la dimension politique de cette pratique artistique, qui ne peut se comprendre que si elle est située dans l’espace public, terrain de lutte politique par excellence.